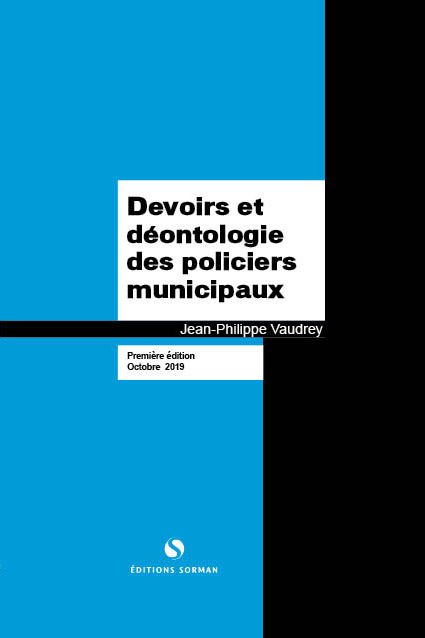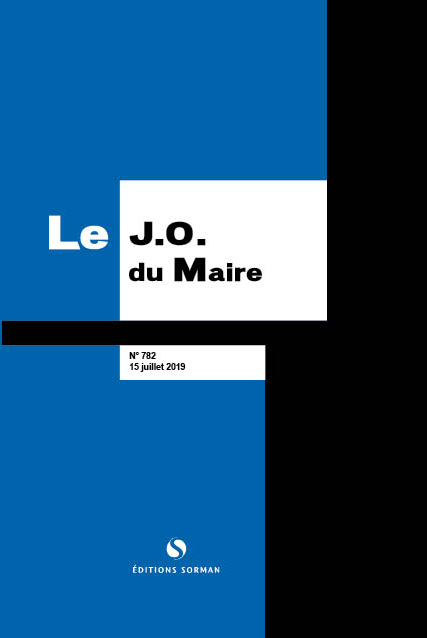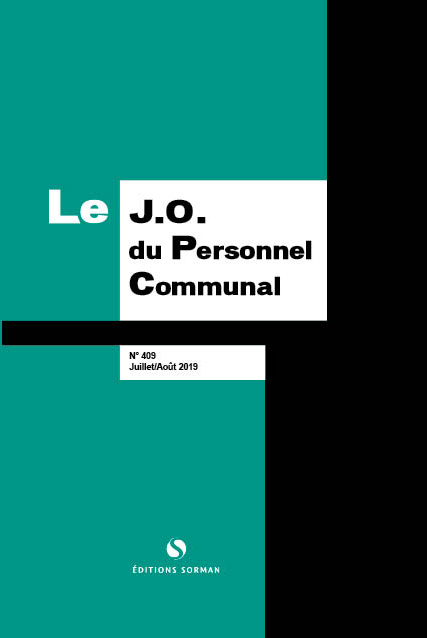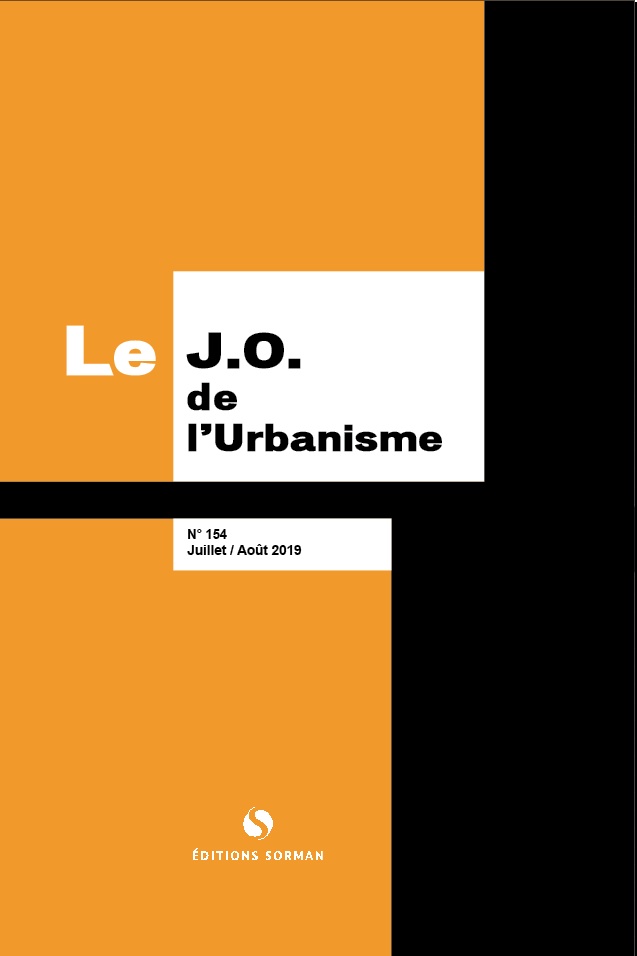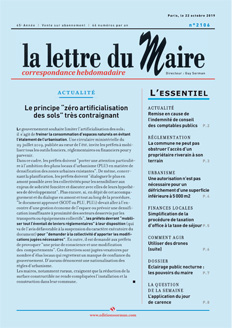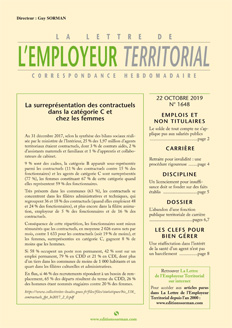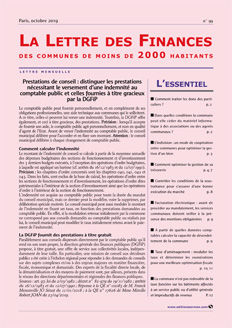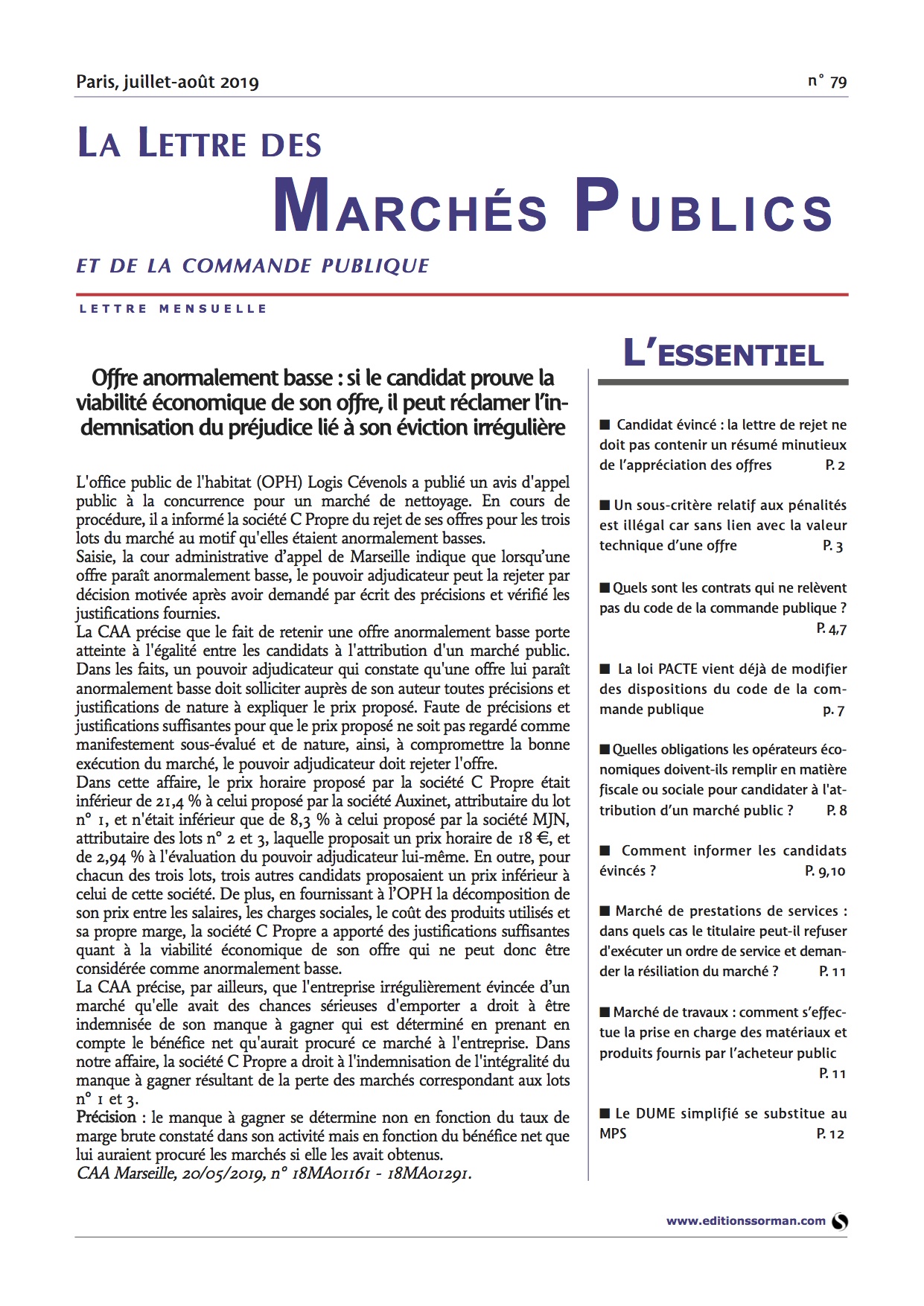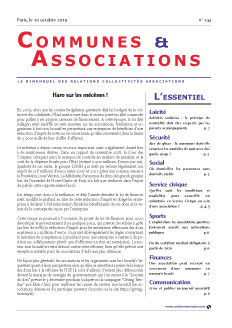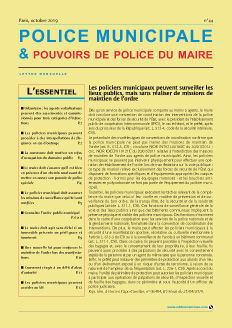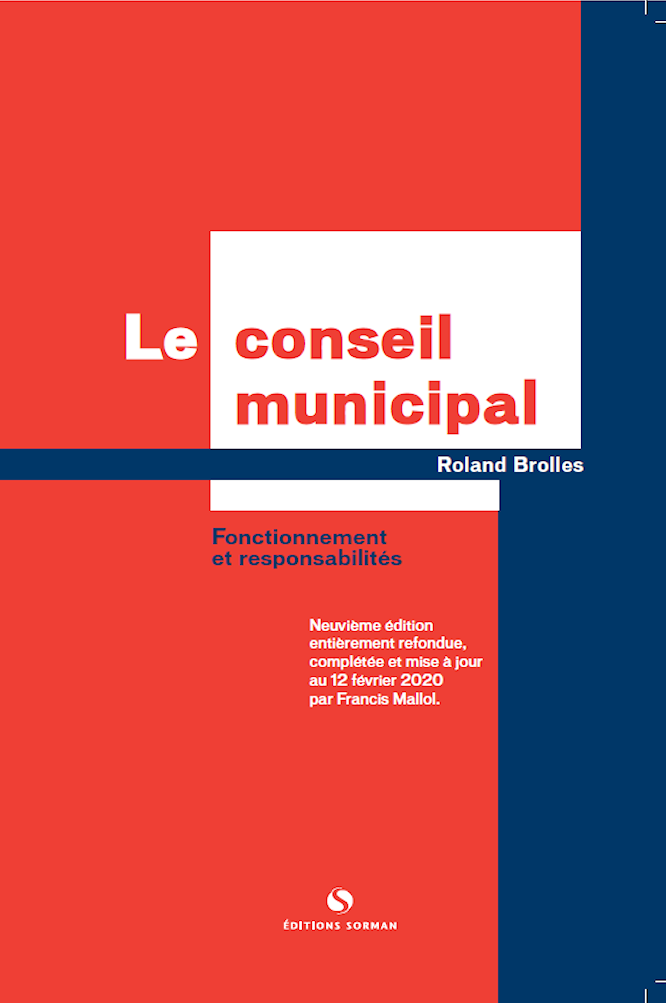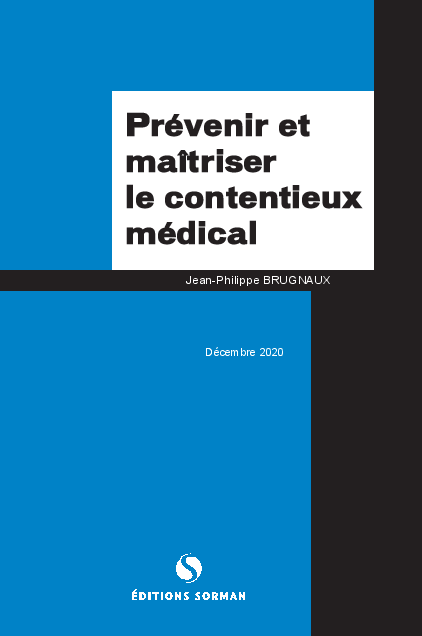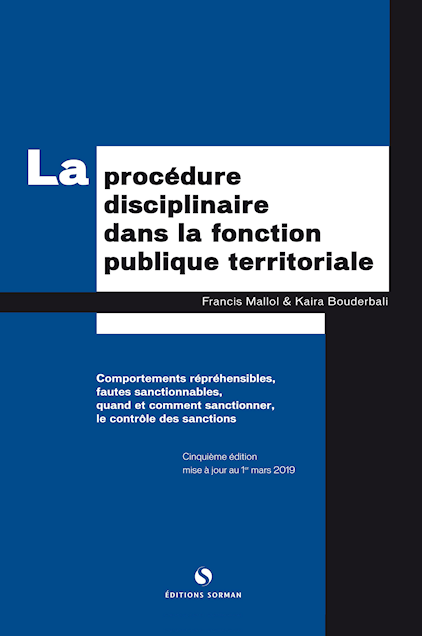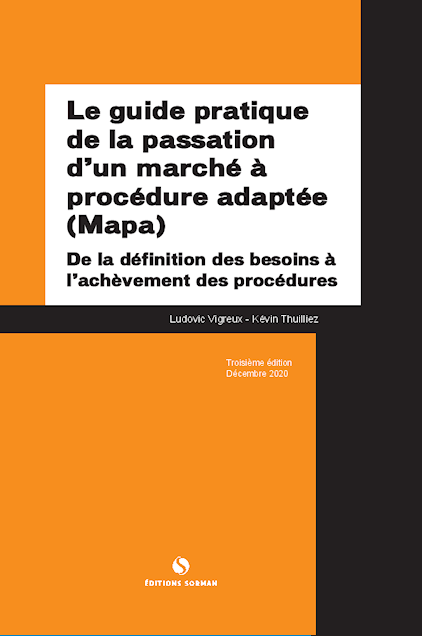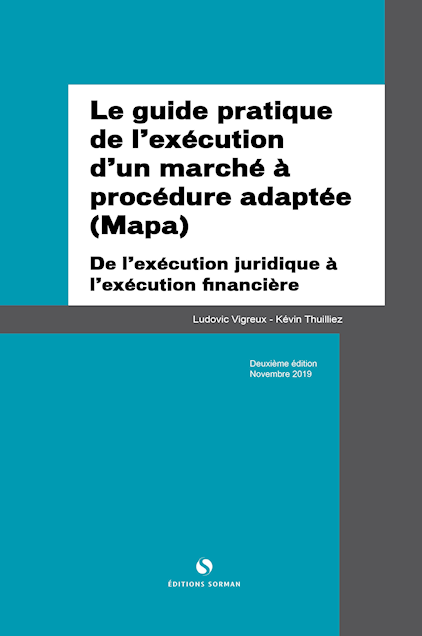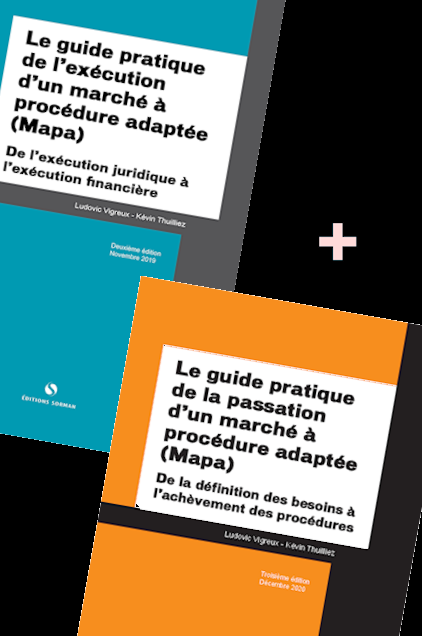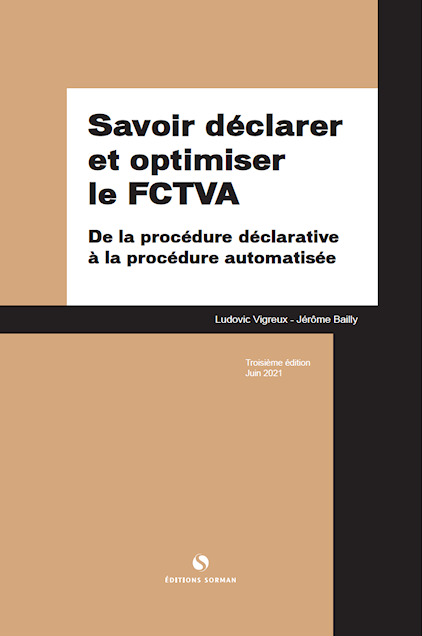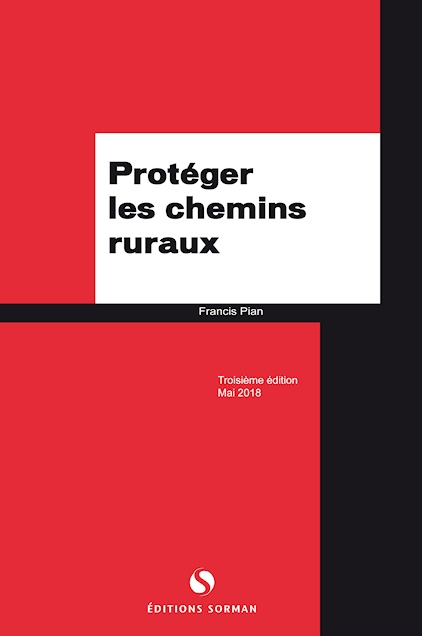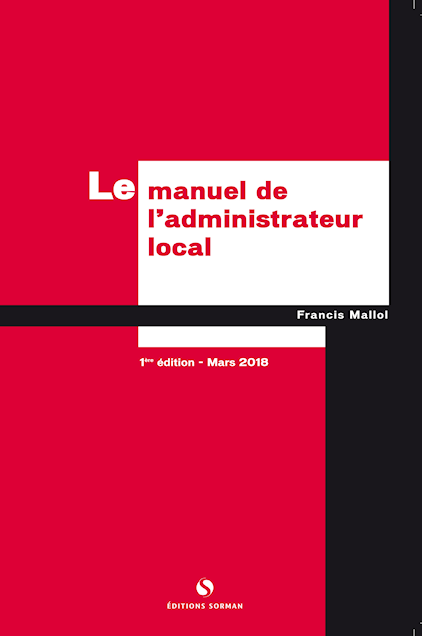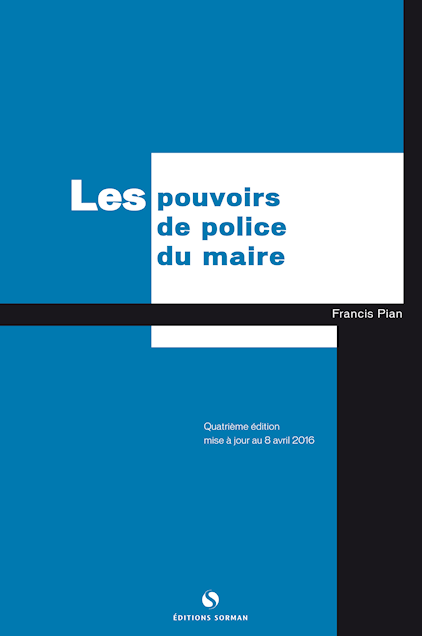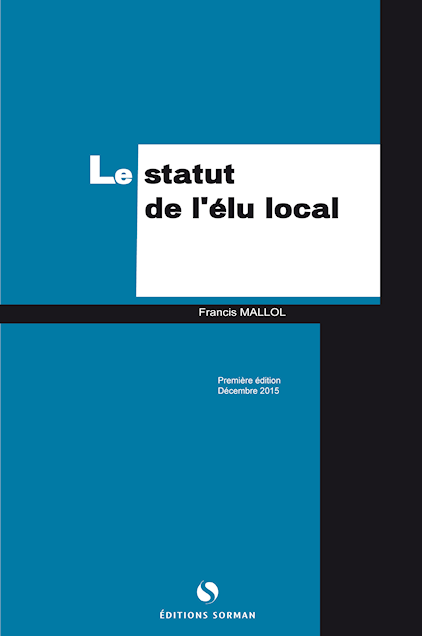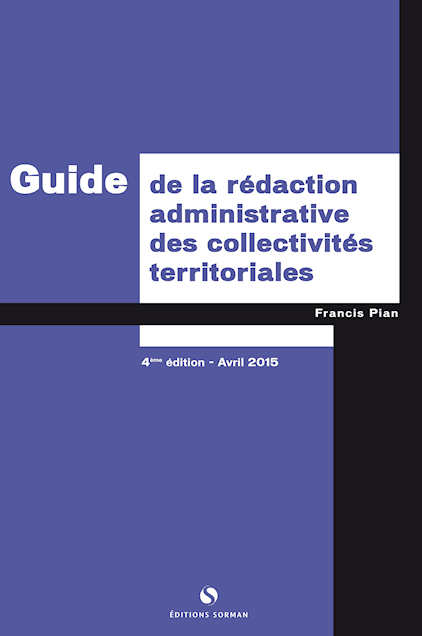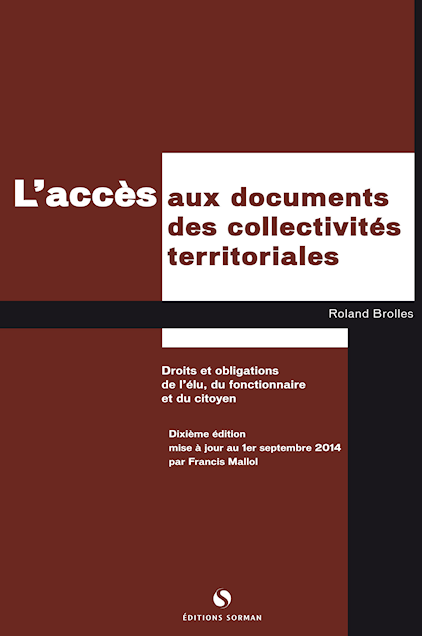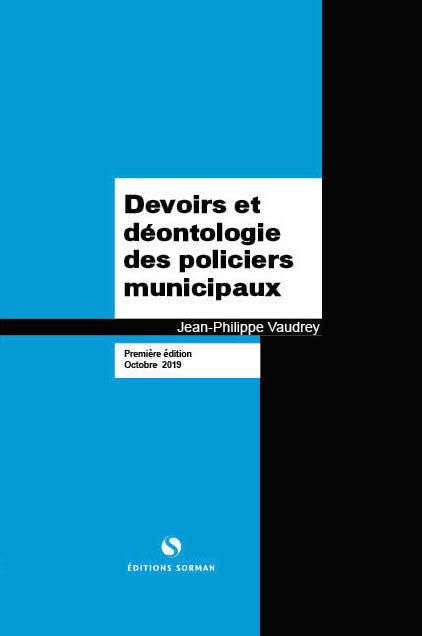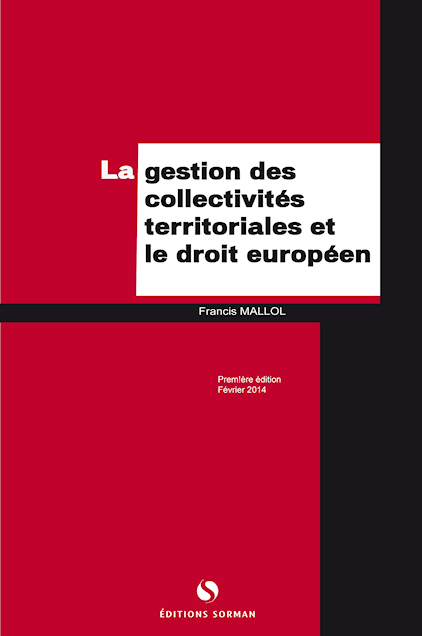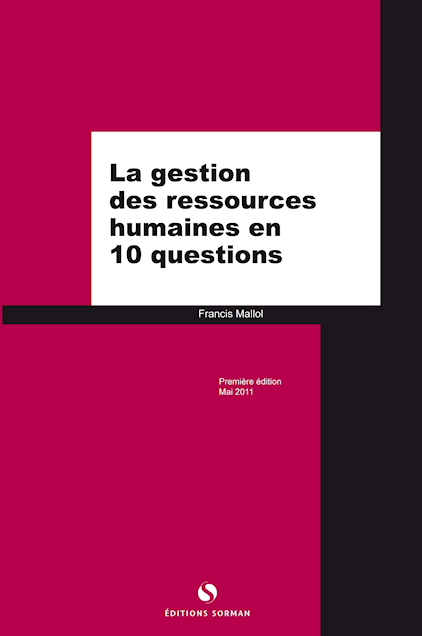Le maire doit assurer la défense extérieure contre l’incendie Abonnés
Le maire est investi d’un pouvoir de police spéciale, par lequel il « assure la défense extérieure contre l'incendie » (art. L 2213-32, code général des collectivités territoriales, CGCT). La défense extérieure contre l’incendie a pour objet « d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire (…) » (art. L 2225-1, CGCT). Ces points sont dénommés « points d'eau incendie ». Ils sont constitués d'ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours.
Les points d’eau sont constitués des bouches et poteaux d'incendie normalisés, mais peuvent être également des points d'eau naturels ou artificiels et d'autres prises d'eau retenus. Tout point d'eau incendie est caractérisé par sa nature, sa localisation et la capacité de la ressource qui l'alimente.
Les communes sont chargées de ce service public municipal et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points pour garantir leur approvisionnement (art. L 2225-2, CGCT).
Important : la responsabilité de la commune peut être recherchée en cas de carence dans la mise en œuvre de ce pouvoir de police spéciale du maire ou en cas de dysfonctionnement du service public municipal. En effet, « (…) les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent (…) » (art. L 2216-2, CGCT). De plus, les contours de ce service public municipal étant maintenant bien définis, les assureurs recherchent désormais la responsabilité des communes en cas de dysfonctionnement (voir cour administrative d’appel de Nantes, n° 16NT01388, 7/06/2017). Il est donc important de veiller à ce que les textes soient strictement respectés.
À retenir : la commune doit créer son service public municipal désormais obligatoire par délibération du conseil municipal.
Le référentiel national définit les principes d’organisation de la défense extérieure contre l’incendie
Pour organiser son service public, la commune doit faire application d’un règlement départemental, qui lui-même fait application d’un référentiel national. Ainsi, le référentiel national définit « les principes de conception et d'organisation de la défense extérieure contre l'incendie et les dispositions générales relatives à l'implantation et à l'utilisation des points d'eau incendie » (art. R 2225-2, CGCT ; arrêté du 15/12/2015). Le référentiel national traite notamment :
1/des différentes modalités de création, d'aménagement, de gestion et d'accessibilité des points d'eau incendie identifiés ;
2/des caractéristiques techniques de ces points ainsi que des modalités de leur signalisation ;
3/des conditions de mise en service et de maintien en condition opérationnelle des points d'eau incendie ;
4/de l'objet des contrôles techniques, des actions de maintenance et des reconnaissances opérationnelles ;
5/des modalités d'échange d'informations entre les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et les services publics de l'eau ;
6/des informations relatives aux points d'eau incendie donnant lieu à recensement et traitement au niveau départemental et des modalités de leur communication aux maires ou aux présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils sont compétents.
Rq : pour consulter le référentiel national, se rendre sur https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/La-defense-exterieure-contre-l-incendie
Le règlement départemental caractérise les risques et définit les besoins en eau
Le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie prend en compte les dispositions du référentiel national et les adapte à la situation du département (art. R 2225-3, CGCT). Il est établi sur la base de l'inventaire des risques du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Le SDIS élabore le projet de règlement en concertation avec les maires, puis le préfet arrête ce dernier. Le règlement départemental a également pour objet de :
1/caractériser les différents risques présentés par l'incendie, en particulier des différents types de bâtiment, d'habitat, ou d'urbanisme ;
2/préciser la méthode d'analyse et les besoins en eau pour chaque type de risque ;
3/préciser les modalités d'intervention en matière de défense extérieure contre l'incendie des communes, du SDIS, des services publics de l'eau, des gestionnaires des autres ressources d'eau et des services de l'État chargés de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction, de l'aménagement rural et de la protection des forêts contre l'incendie, ainsi que, le cas échéant, d'autres acteurs et notamment le département et les établissements publics de l'État concernés ;
4/intégrer les besoins en eau définis par les plans départementaux ou interdépartementaux de protection des forêts contre les incendies ;
5/fixer les modalités d'exécution et la périodicité des contrôles techniques, des actions de maintenance et des reconnaissances opérationnelles des points d'eau ;
6/définir les conditions dans lesquelles le SDIS apporte son expertise en matière de défense extérieure contre l'incendie aux maires ;
7/déterminer les informations qui doivent être fournies par les différents acteurs sur les points d'eau incendie.
Conseil : se rapprocher du SDIS pour obtenir le règlement départemental.
Le maire peut établir un schéma communal de défense extérieure contre l’incendie
Le maire doit faire application du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie. Il doit également :
1/identifier les risques à prendre en compte ;
2/fixer en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des SDIS, ainsi que leurs ressources.
De plus, le maire doit veiller à l’intégration des besoins en eau :
1/nécessaires à la défense des espaces naturels lorsque la commune relève du régime des bois et forêts classés à risque d’incendie ou lorsque son territoire est réputé particulièrement exposé aux risques d’incendie (art. L 132-1, L 133-1, code forestier) ;
2/qui résultent d'un plan de prévention approuvé des risques technologiques ou d'un plan de prévention approuvé des risques naturels prévisibles (art. L 515-5, L 562-1, code de l’environnement) ;
3/définis par les réglementations relatives à la lutte contre l'incendie spécifiques à certains sites ou établissements, notamment les établissements recevant du public ;
4/relatifs à la lutte contre l'incendie des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque ces besoins, prescrits à l'exploitant par la réglementation spécifique, sont couverts par des équipements publics.
Ces mesures doivent garantir la cohérence d'ensemble du dispositif de lutte contre l'incendie. Le maire les édicte par un arrêté.
Rappel : la mise à disposition d'un point d'eau pour être intégré aux points d'eau incendie requiert l'accord de son propriétaire (art. R 2225-1, CGCT). Le propriétaire et la commune doivent conclure une convention qui peut fixer les modalités de restitution de l'eau utilisée au titre de la défense extérieure contre l'incendie, la gestion de la répartition de la ressource pour les besoins du propriétaire et pour ceux du service public ainsi que la répartition des dépenses (art. R 2225-7, CGCT).
À savoir : avant d’édicter son arrêté, le maire peut établir un schéma communal de défense extérieure contre l’incendie (art. R 2225-5, CGCT). À cet effet, le maire doit faire application du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie et :
1/dresser l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie existante ;
2/identifier les risques à prendre en compte en intégrant leur évolution prévisible ;
3/vérifier l'adéquation entre la défense extérieure contre l'incendie existante et les risques à défendre ;
4/fixer les objectifs permettant d'améliorer cette défense ;
5/planifier, en tant que de besoin, la mise en place d'équipements supplémentaires.
Le schéma prend en compte le schéma de distribution d'eau potable (art. L 2224-7-1, CGCT). Le maire doit solliciter l'expertise du SDIS (art. R 2225-5, CGCT), puis son avis qui est transmis dans un délai de 2 mois (pour les autres consultations, voir art. R 2225-3-I 3°, CGCT).
Précision : lorsque le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie, ce dernier peut élaborer un schéma intercommunal de défense extérieure contre l'incendie. Le président de l'établissement public doit recueillir l'avis des maires ainsi que des autres intervenants.
Le maire doit réaliser des opérations de contrôle des points d’eau
Le maire doit organiser des contrôles techniques périodiques des points d'eau incendie. Ces contrôles ont pour objet d'évaluer leurs capacités. Le règlement départemental définit les modalités d'exécution et la périodicité de ces contrôles (art. R 2225-9, CGCT).
Par ailleurs, le SDIS doit procéder à des reconnaissances des points d'eau incendie destinées à vérifier leur disponibilité opérationnelle, après information préalable du maire (art. R 2225-10, CGCT).
Les communes doivent supporter le coût des dépenses de ce service public
Les communes doivent supporter le coût des dépenses relatif :
1/aux travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés ;
2/à l’accessibilité, la numérotation et la signalisation des points d'eau ;
3/à la réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de leur approvisionnement en amont des points d’eau ;
4/à toutes les mesures nécessaires à leur gestion ;
5/aux actions de maintenance destinées à préserver leurs capacités opérationnelles (art. R 2225-7, CGCT ; pour les dépenses à la charge des ERP, voir même article).
Lorsque l'approvisionnement des points d'eau fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par la commune (art. L 2225-3, CGCT ; voir également art. R 2225-7, CGCT).
Le maire doit participer à la prévention des incendies
Le maire doit également apporter son concours à la lutte contre les incendies, en application de son pouvoir de police municipale. En effet, la police municipale a pour objet « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) : 5/le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies (…), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (…) » (art. L 2212-2, CGCT).
De plus, « en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'État dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites » (art. L 2212-4, CGCT). La jurisprudence précise qu’il en est ainsi en « présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent ».
Le maire peut alors « faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées à cette situation » (Conseil d’État, n° 04592, 20/06/1980, commune d’Ax-les-Thermes ; cour administrative d’appel de Marseille, n° 08MA02140, 18/10/2010, commune d’Agde).
À savoir : en cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, la commune peut « se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie » (art. 2-7, code de procédure pénale).
Références : Art. L 2213-2, L 2225-1 et svts, R 2225-1 et svts, CGCT ; art. 77, loi n° 2011-525 du 17/05/2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ; décret n° 2015-235 du 27/02/2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie.
Antoine Laloy le 01 septembre 2017 - n°21 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline