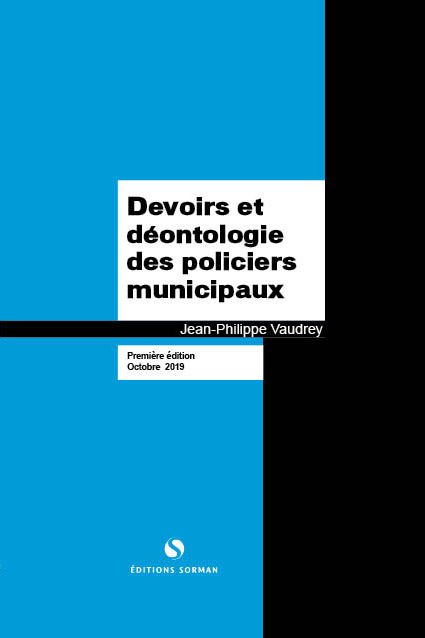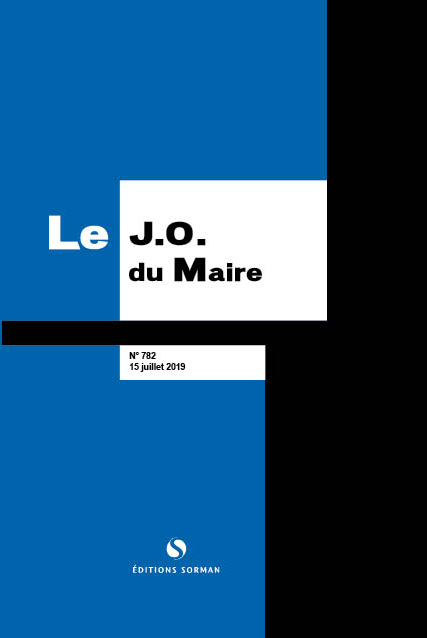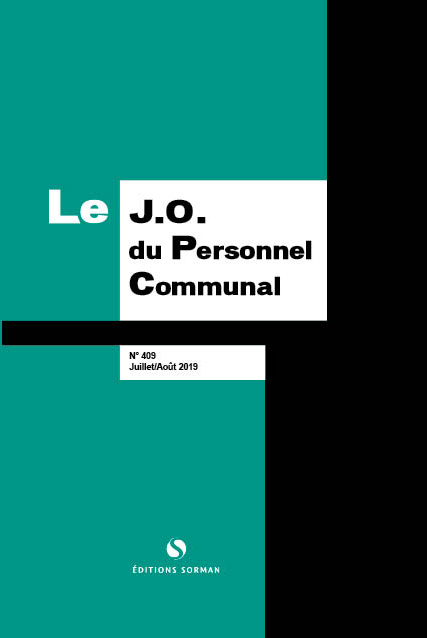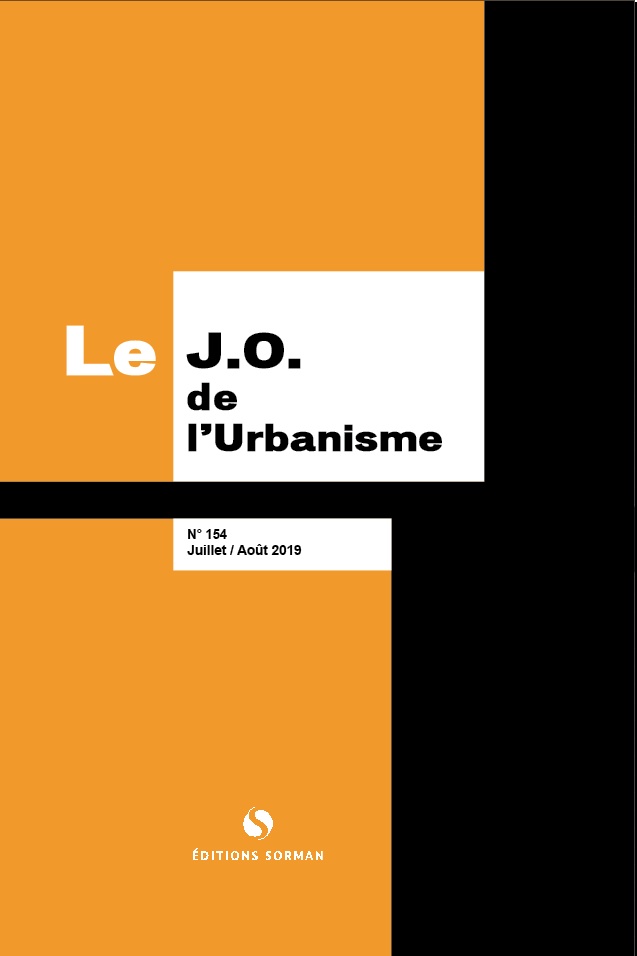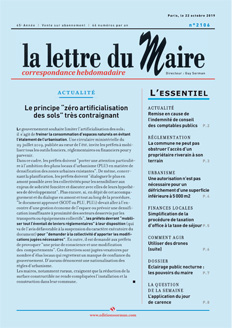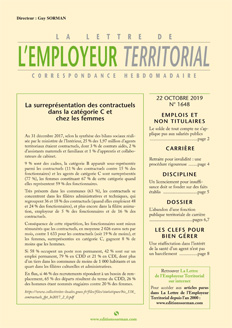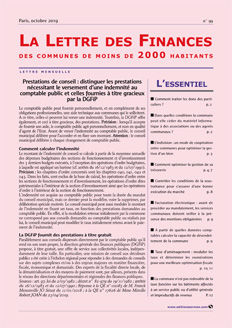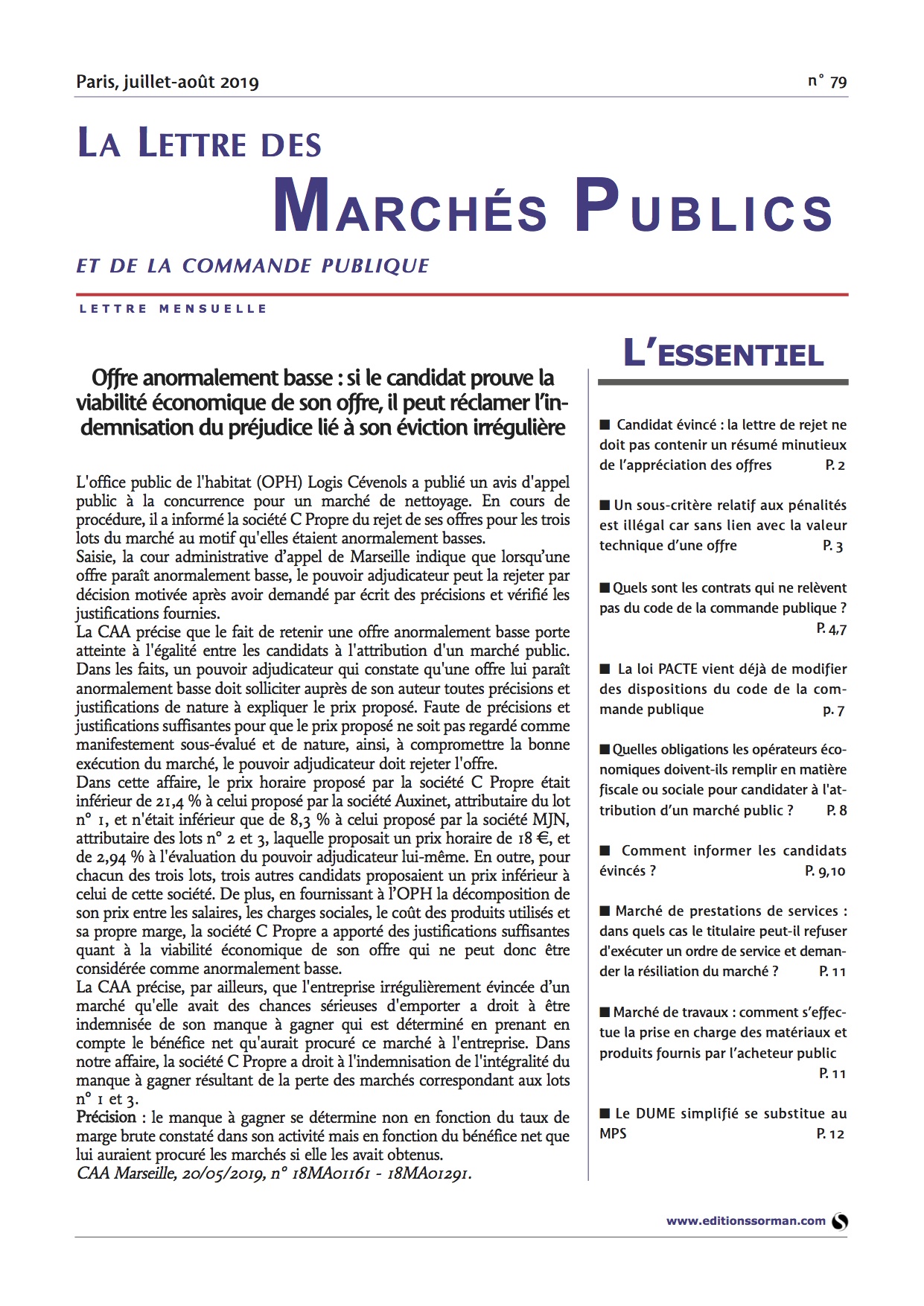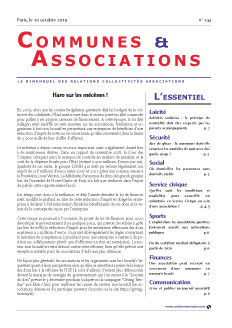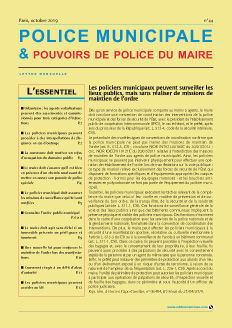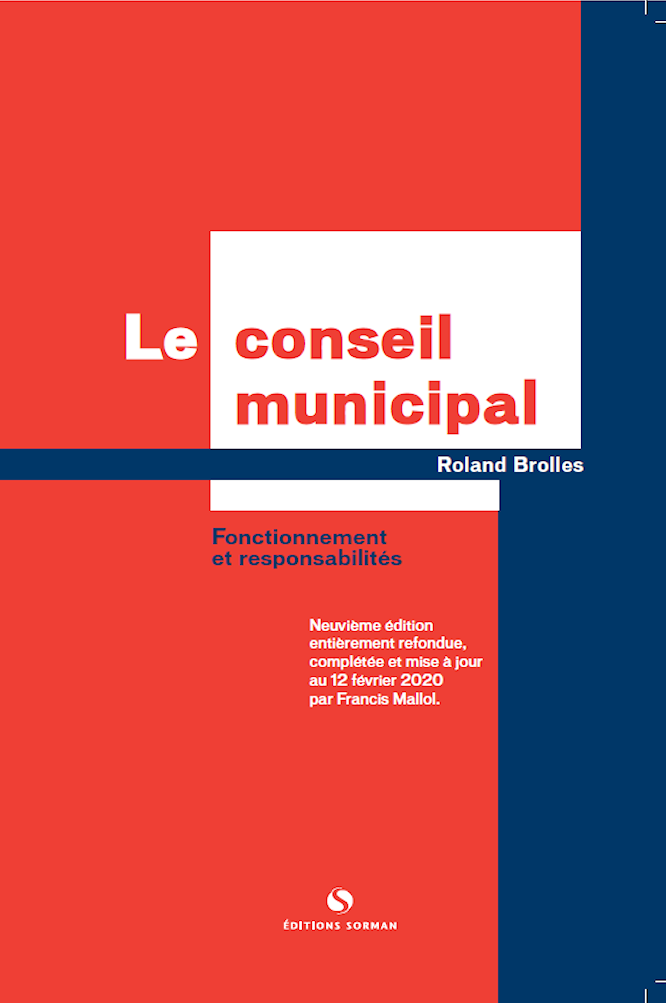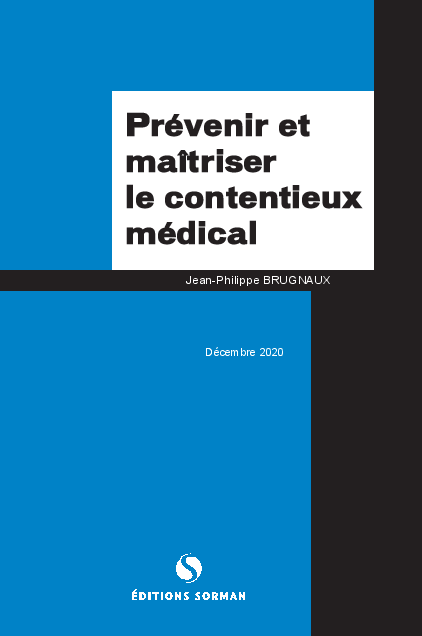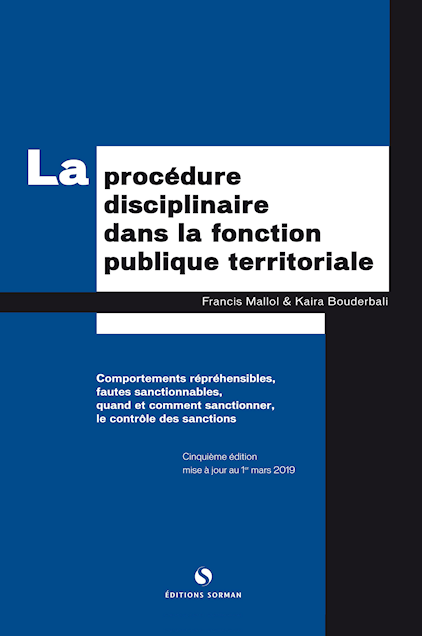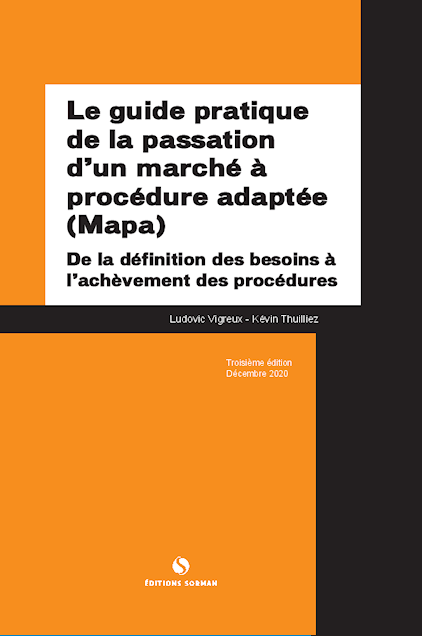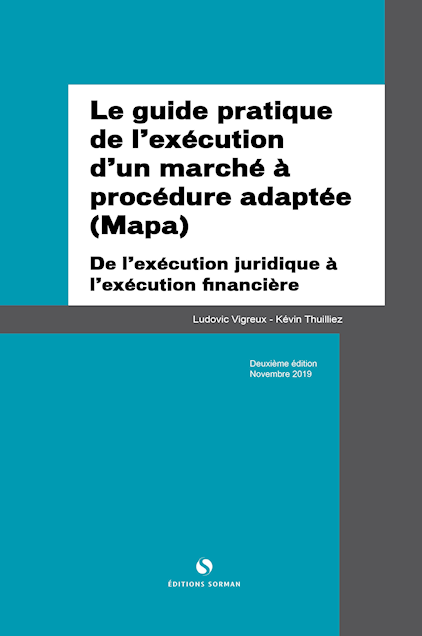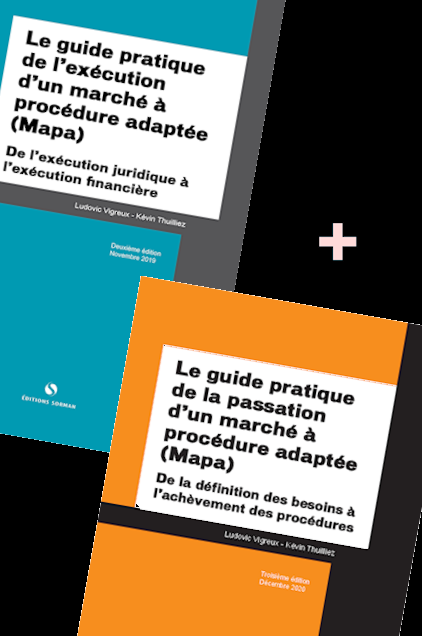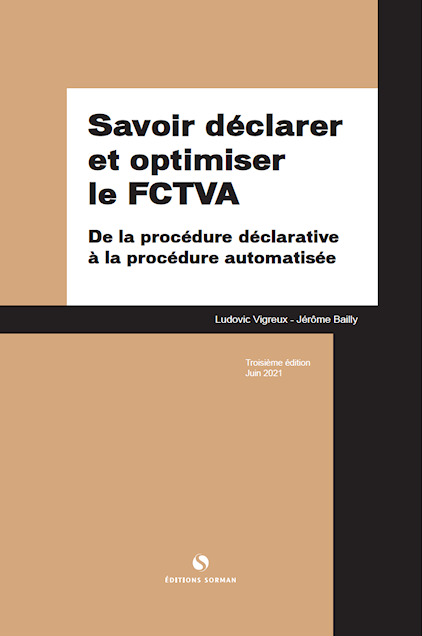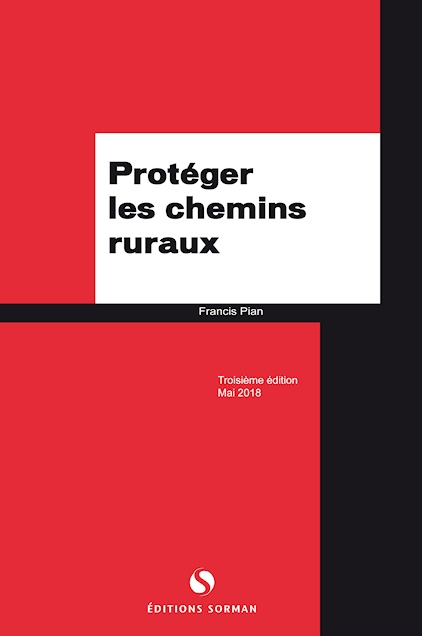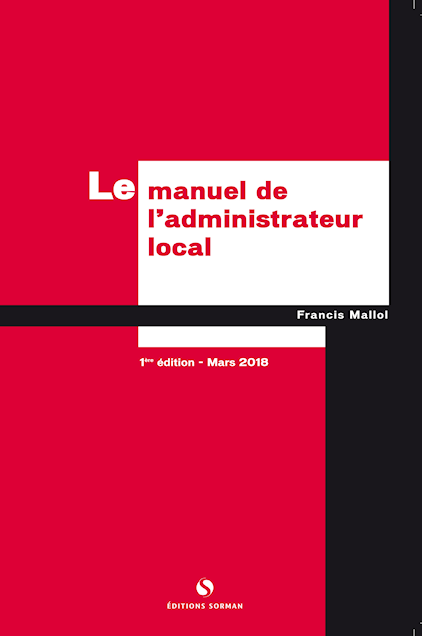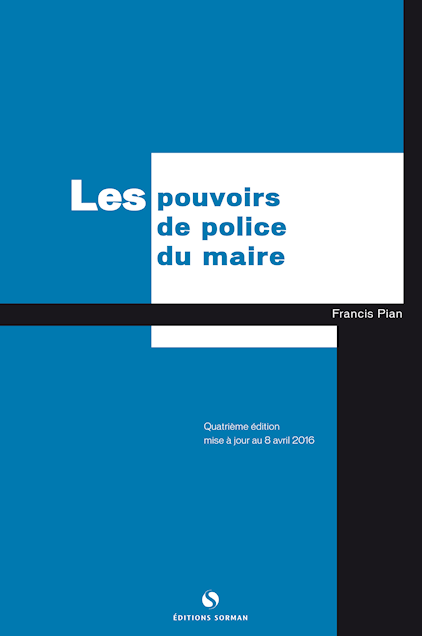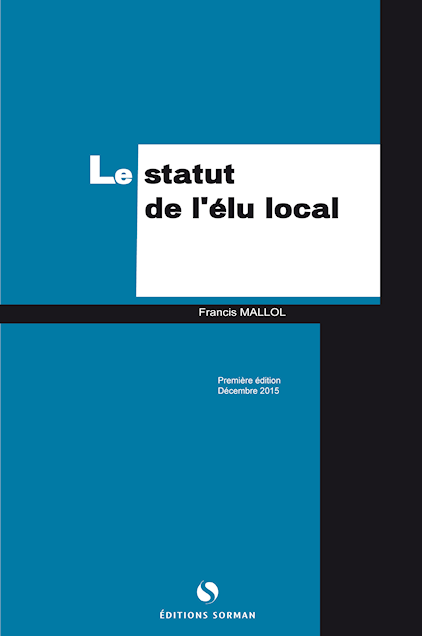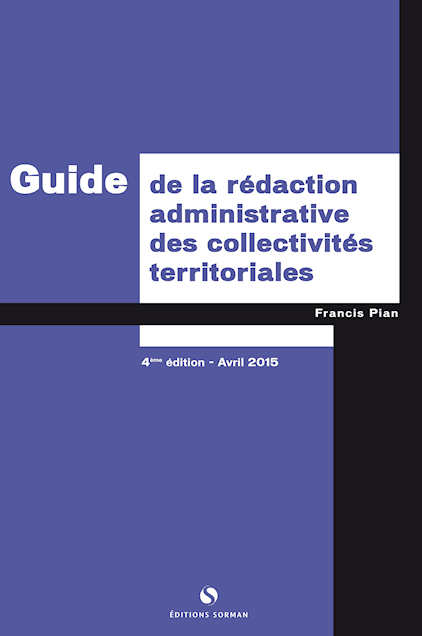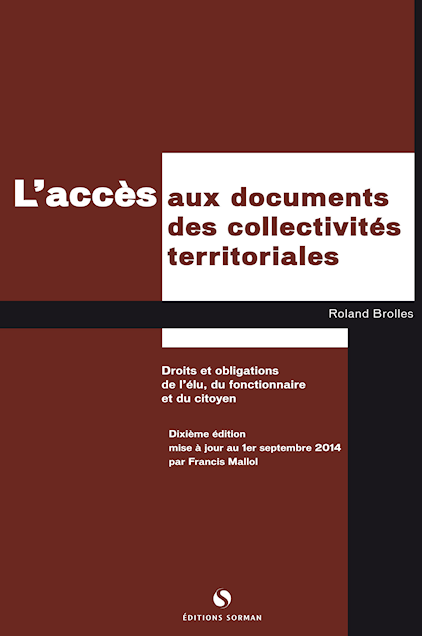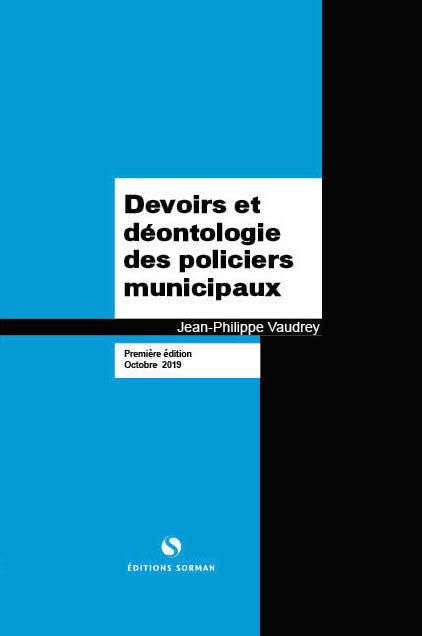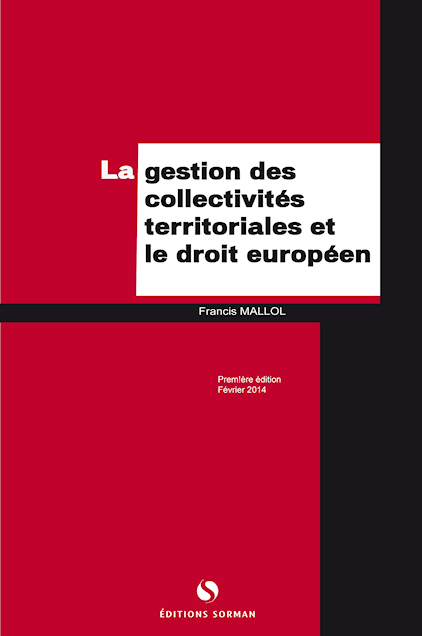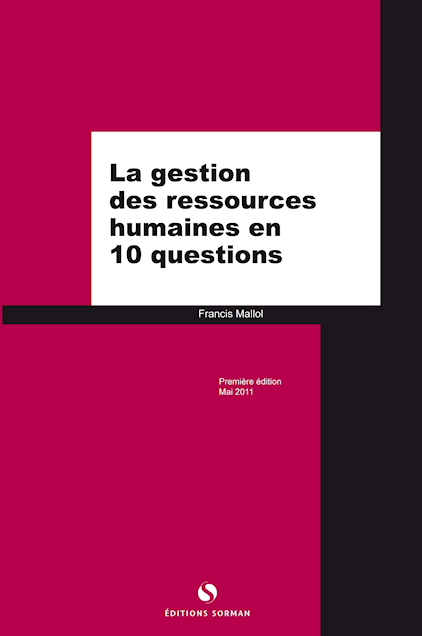Comment réagir face à une opposition à travaux publics Abonnés
L’élément légal est « le fait de s'opposer, par voies de fait ou violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique ». L’infraction est punie d’un an de prison et 15 000 € d'amende (article 433-11 du code pénal, CP). De plus, l’auteur du délit encourt des peines complémentaires d’interdiction d’exercer ses droits civiques, civils et de famille, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique (article 131-26 du même code). Le juge pénal interprète très largement la notion de travaux publics : il s’agit de travaux exécutés dans un but d'intérêt général ou en vue d'un service public et qui portent sur un bien immobilier (voir Tribunal des Conflits, 1/08/1896 ; Cour de Cassation, CC, 11/07/2012).
L’intimidation peut constituer une violence
L’élément matériel du délit est le fait de s’opposer aux travaux par des violences portées aux personnes, mêmes si ces violences sont légères. Il peut également s’agir de violences contre les choses, comme la destruction de lampadaires, d’engins de chantier ou même le déplacement de bornes posées pour un remembrement (CC, 14/02/1956).
Le délit d’opposition à exécution de travaux sanctionne également les voies de fait (au sens du droit pénal), c’est-à-dire les cas où l’individu profère des propos ou adopte un comportement tel qu’il cause une impression violente qui pousse à cesser des travaux. Par exemple, lorsque des individus s’introduisent sur un chantier et effraient les agents à l’aide de fusils, ou encore, lorsque des personnes ont un comportement très belliqueux, les agents devant quitter le chantier (CC, 5/04/1949).
La commune peut déposer plainte et se constituer partie civile
L’élément intentionnel du délit est constitué dès lors que l’auteur présumé du délit sait qu’il s’oppose sciemment à l’exécution de travaux publics.
Lorsque les 3 critères du délit sont réunis, la commune dispose de plusieurs possibilités : 1/ elle peut porter plainte à la police ou à la gendarmerie nationale ; 2/ le maire peut également porter plainte directement auprès du procureur de la République (article 40, code de procédure pénale, CPP) ; 3/ la commune peut aussi déposer une plainte avec constitution de partie civile, devant le doyen des juges d’instruction, ce qui permet la mise en mouvement de l’action publique et de demander des dommages et intérêts (article 85, CPP).
La commune doit justifier d’un préjudice personnel et direct. Le juge d’instruction peut solliciter le versement d’une consignation (article 88, CPP ; voir l’ensemble des conditions aux articles 85 et suivants, CPP) ; 4/ la commune peut aussi se constituer partie civile à l'audience pour demander des dommages et intérêts (article 418 et suivants, CPP).
Kelly Pizarro le 01 septembre 2017 - n°21 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline