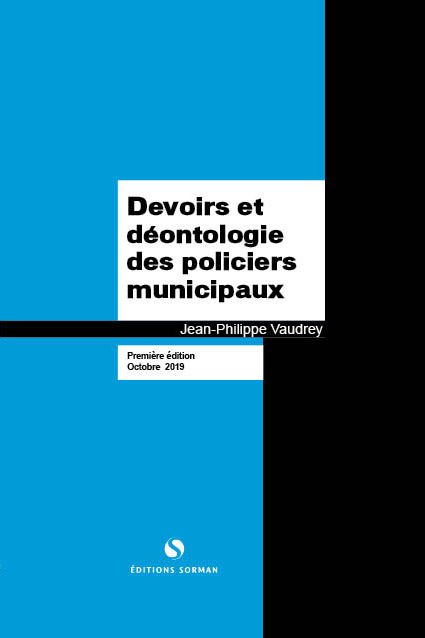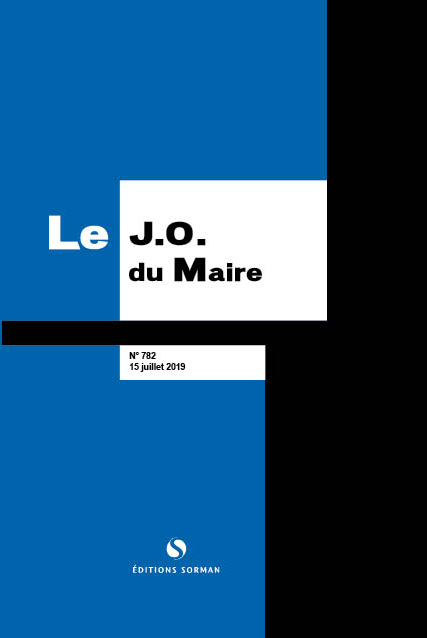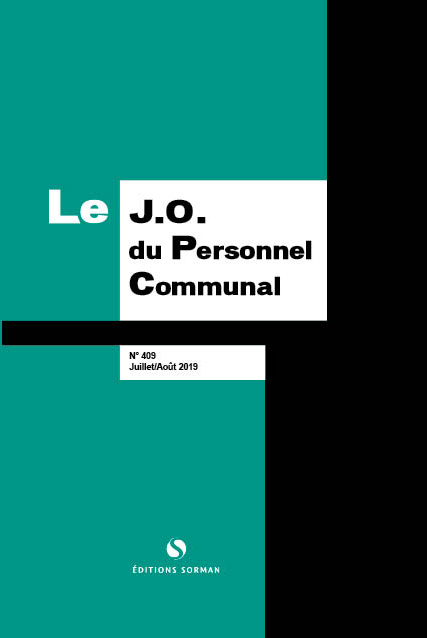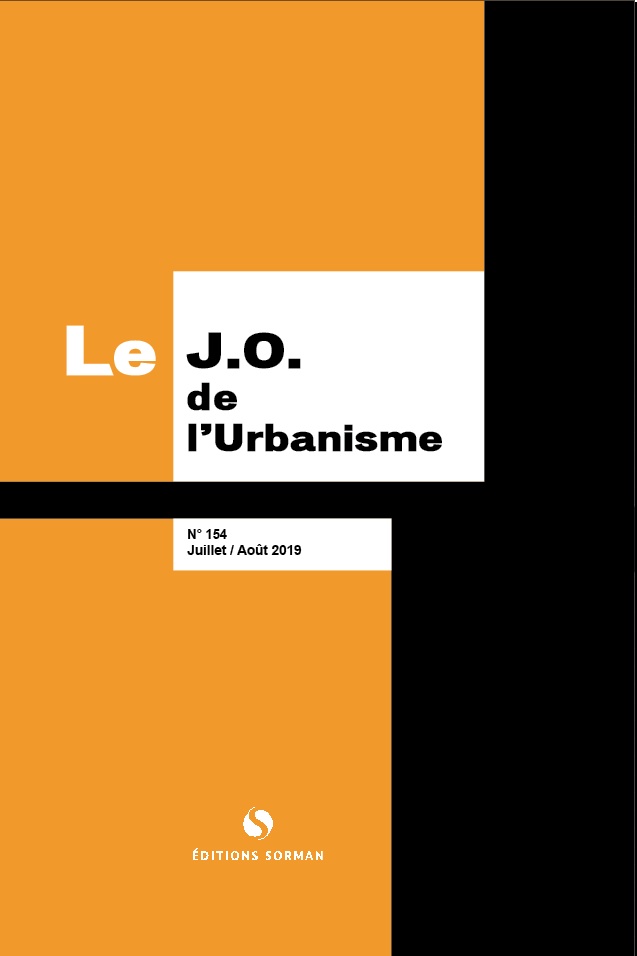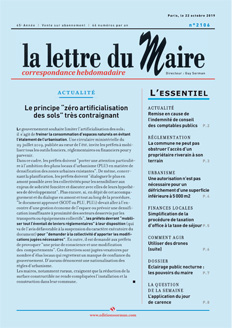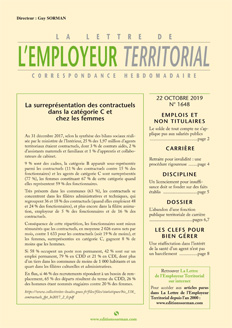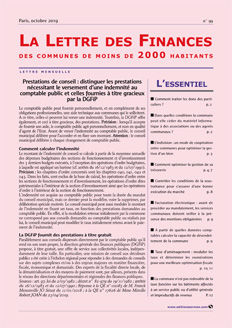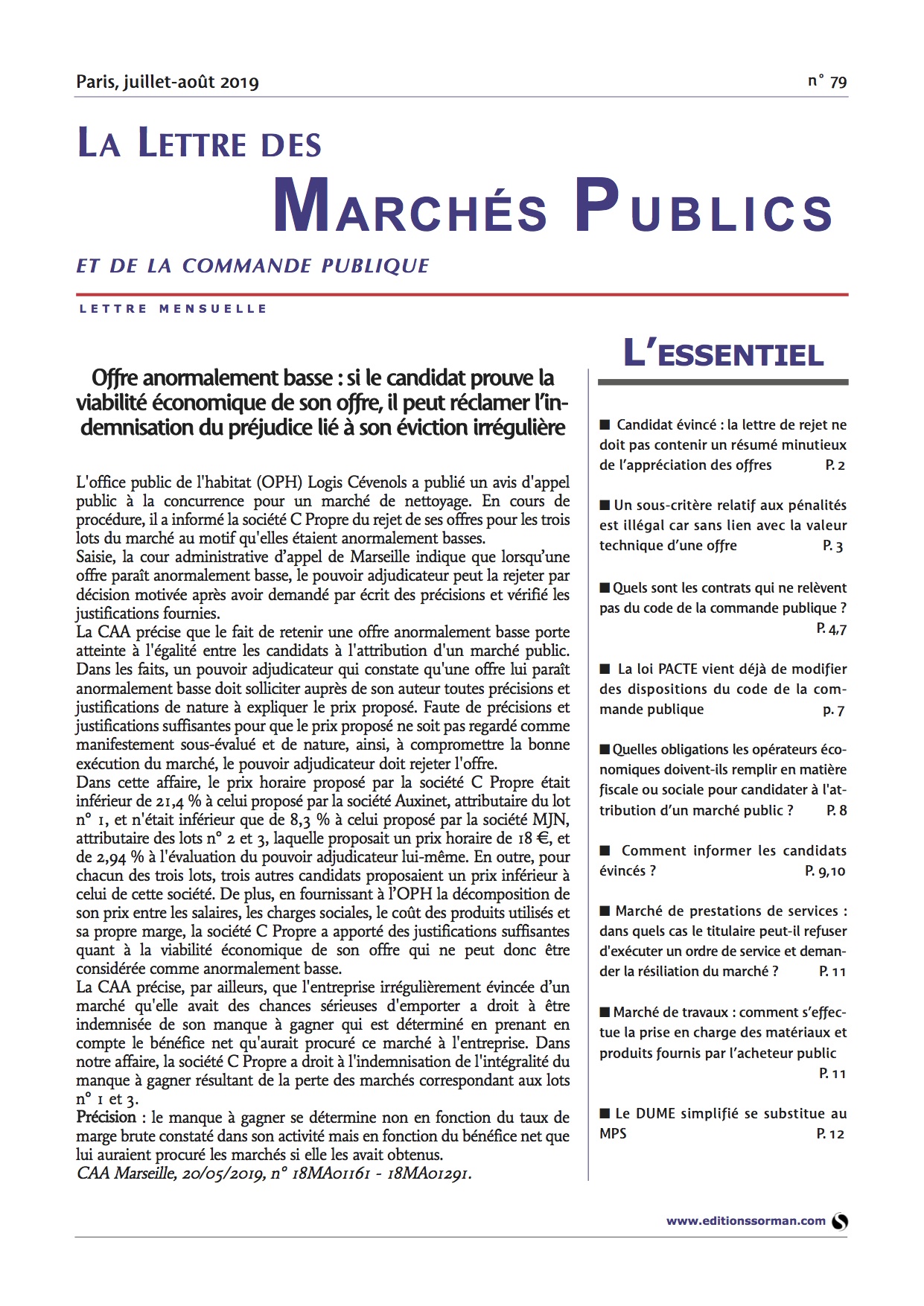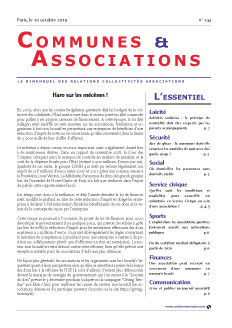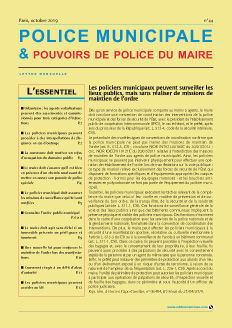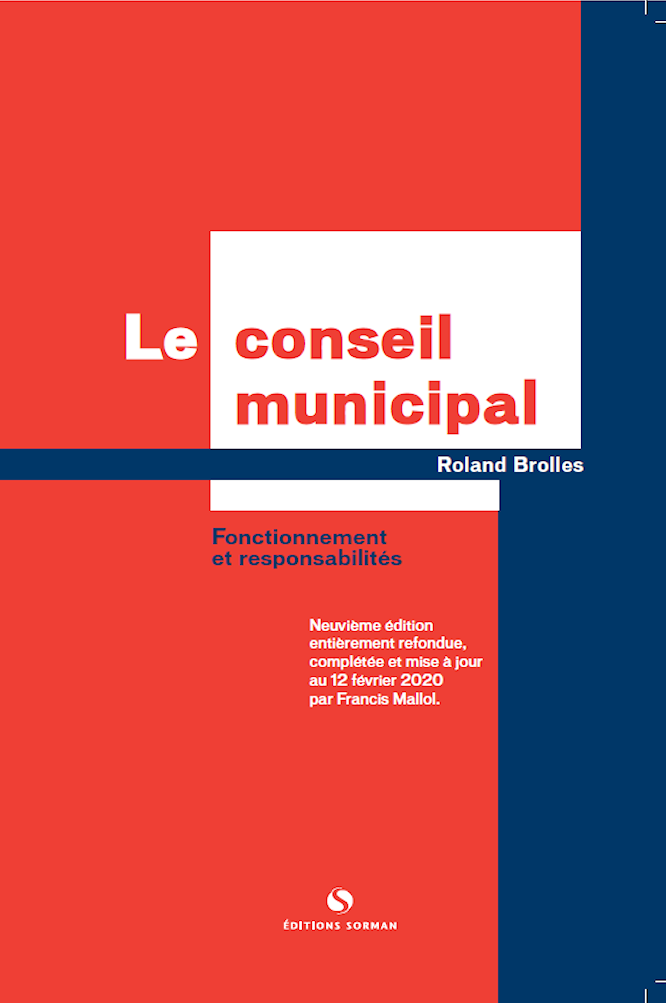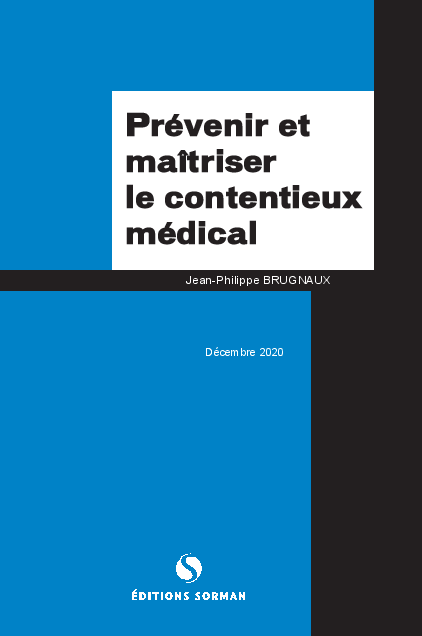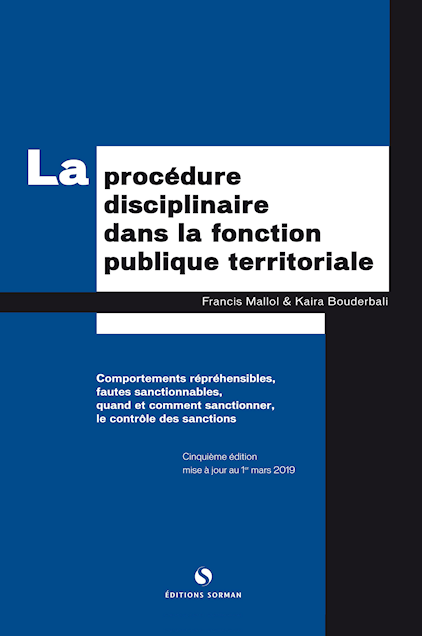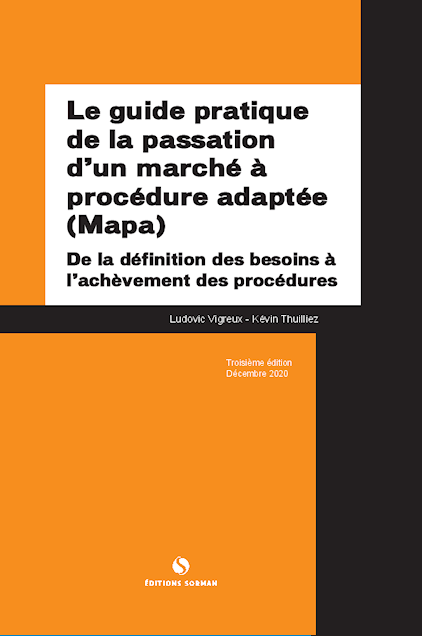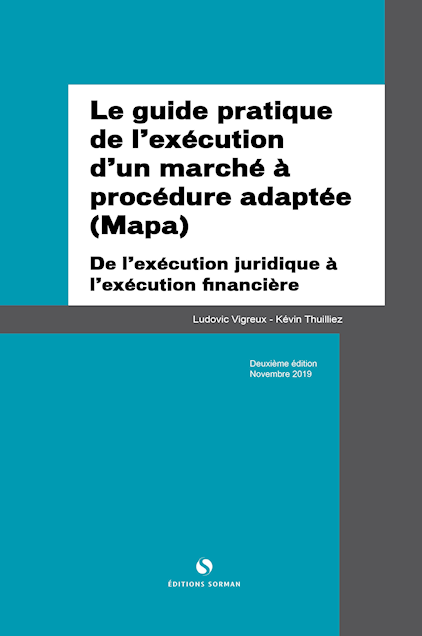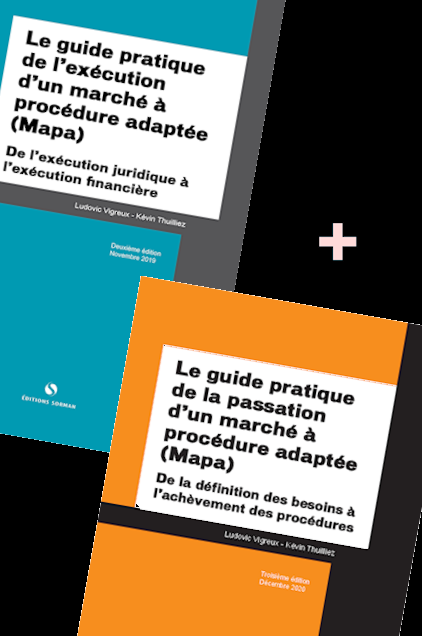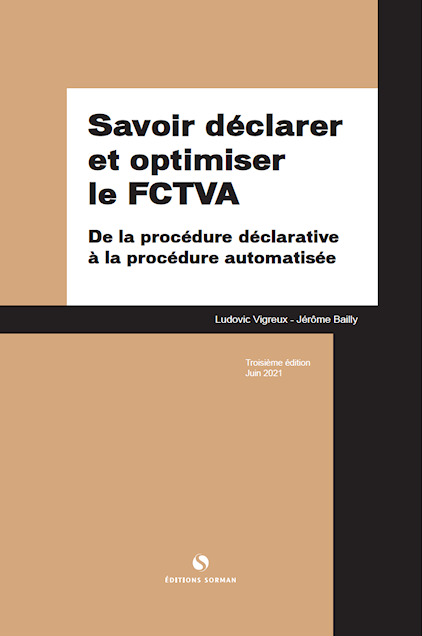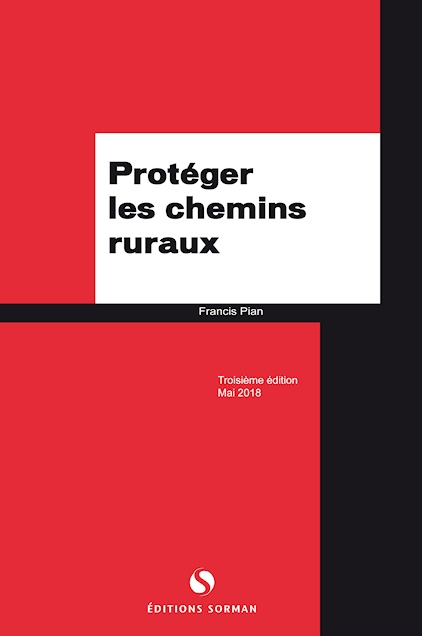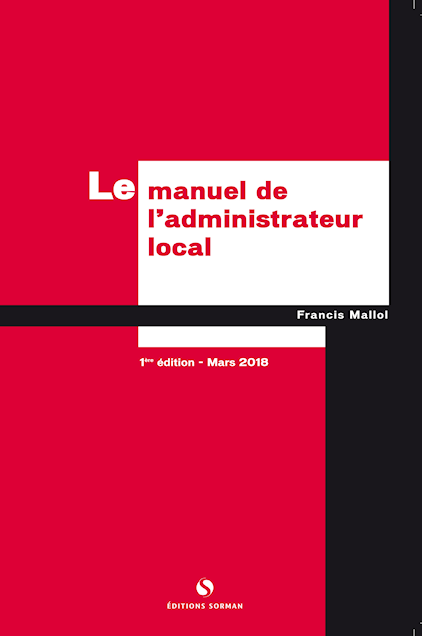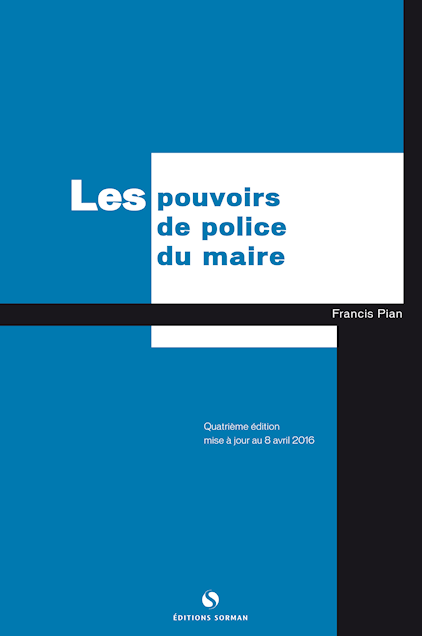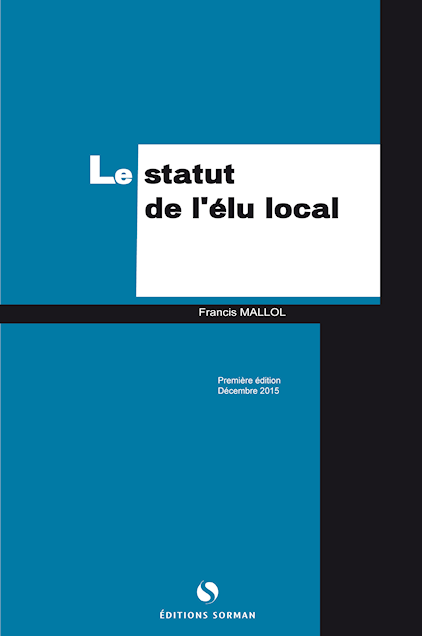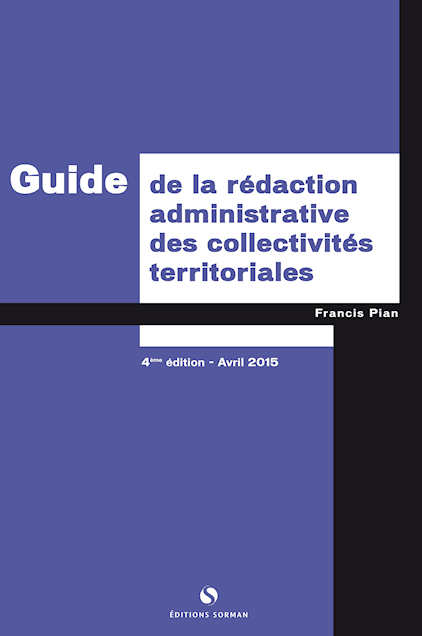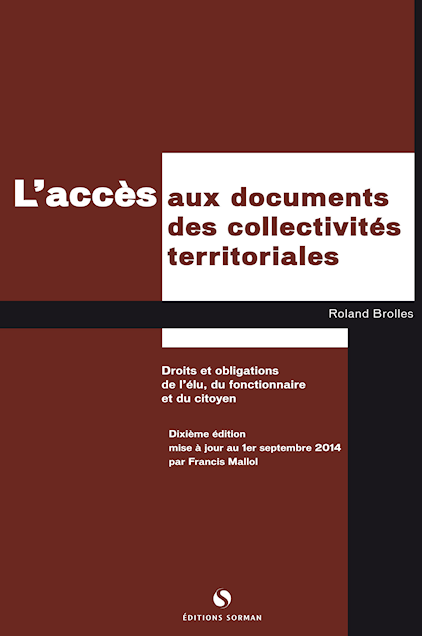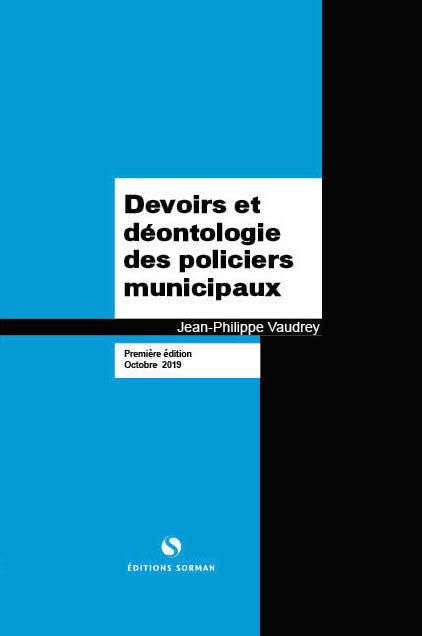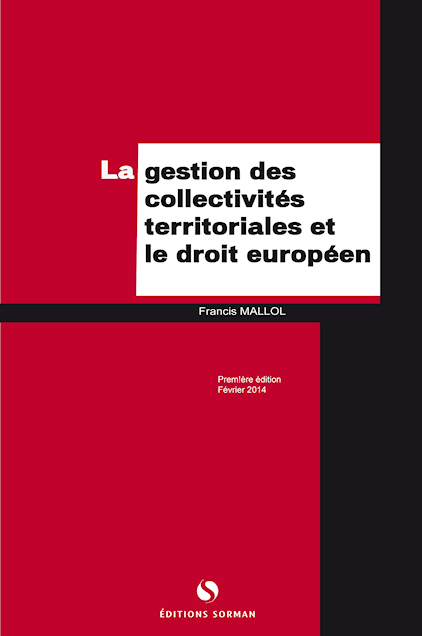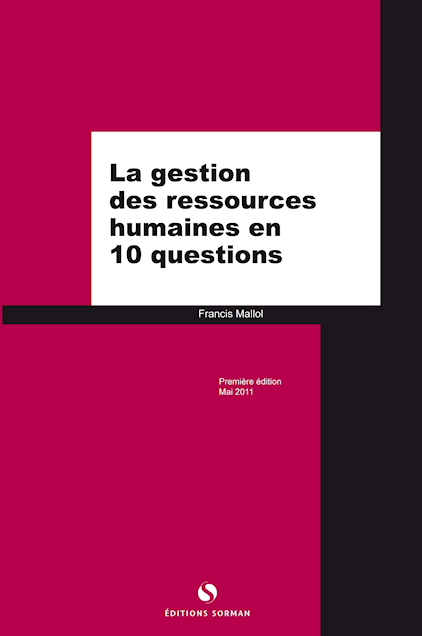Communes à police d’Etat : la répartition des pouvoirs de police entre le maire et le préfet Abonnés
Les communes peuvent bénéficier d’un régime de police d’Etat, c’est-à-dire être dotées d’une police nationale compte tenu de leurs besoins en matière de sécurité. Ces besoins s'apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance » (art. L. 2214-1, code général des collectivités territoriales, CGCT). Ce régime de police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies :
1/la population de la commune ou de l'ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, est supérieure à 20 000 habitants ;
2/les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines.
Le régime de police d’Etat est établi par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et des ministres chargés du Budget, des Collectivités locales et, le cas échéant, de l'Outre-mer, lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, et, à défaut, par décret en Conseil d'Etat (art. R. 2214-2, CGCT). Les communes chefs-lieux de département sont placées de plein droit sous le régime de la police d'Etat (art. R. 2214-1, CGCT).
Le maire et le préfet partagent l’exercice des pouvoirs de police dans les communes à régime de police d’Etat
Dans les communes disposant d’un régime à police d’Etat, le maire et le préfet disposent chacun de prérogatives de police spécifiques. En effet, « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2/ de l'article L. 2212-2 du CGCT et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage.
Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. Tous les autres pouvoirs de police énumérés à l’article L. 2212-2 (…) sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics » (art. L. 2214-4, CGCT).
Très concrètement, le maire conserve dans ces communes les prérogatives de police suivantes :
- 1/tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction d’exposer quelque chose aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de jeter quelque chose qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées,
- 2/le soin de réprimer les troubles de voisinage,
- 3/le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes non occasionnels, dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics,
- 4/l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
- 5/le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure,
- 6/le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés,
- 7/le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
Par ailleurs, le maire peut, même en présence d’une police d’Etat « par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (…) la tranquillité publique (…) » (art. L. 2213-4, CGCT ; CAA de Bordeaux, n° 00BX02300, 29/03/2005).
Quant au préfet, il dispose dans ces communes des prérogatives lui permettant :
- de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique, à l’exclusion des troubles de voisinage,
- d’assurer le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements occasionnels d'hommes.
Dès lors, seul le préfet est compétent pour interdire les manifestations dans ces communes (Conseil d’Etat, CE, n° 74018, 28/04/1989). Cette compétence est également rappelée dans le code de la sécurité intérieure : « si l'autorité investie des pouvoirs de police (NDLR : le préfet dans les communes à police d’Etat) estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu » (art. L. 211-4, code de la sécurité intérieure). En ce qui concerne les grands rassemblements d’hommes, le préfet est compétent dès lors que ces derniers se produisent de façon occasionnelle.
A savoir : est punie de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, « l’organisation sur la voie publique d'une manifestation n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues par la loi, ou ayant fait l'objet d'une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée, ou encore ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi » (art. L. 211-12, CSI, art. 431-9, code pénal). Par ailleurs, l'Etat est civilement responsable « des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’Etat peut exercer une action récursoire contre la commune seulement lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée (art. L. 211-10, code de la sécurité intérieure).
Enfin, rappelons que « dans les communes où le régime de la police d'Etat est institué, les forces de police étatisée sont chargées, notamment, d'exécuter les arrêtés de police du maire » (art. L. 2214-3, CGCT).
Faire respecter la répartition des compétences
La répartition des prérogatives entre le maire et le préfet doit être respectée très strictement sous peine de nullité de l’arrêté en cas de contentieux. En effet, si le maire prend un arrêté à la place du préfet ou inversement, il y aura incompétence de l’auteur de l’acte.
Conseil : dans les communes dotées d’une police d’Etat, la répartition des compétences entre maire et préfet n’est pas toujours bien respectée. Côté commune, le maire peut penser qu’il est plus simple et plus rapide de prendre soi-même un arrêté, surtout si cette pratique est ancienne. Du côté du préfet, il peut aussi exister un intérêt à ce que le maire édicte lui-même certains arrêtés, notamment pour des raisons politiques. Mais en cas de contentieux, les juges s’en tiennent aux textes et annuleront les arrêtés si les compétences ne sont pas respectées. Aussi, il peut être utile par exemple à l’occasion d’une séance du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, d’échanger sur ce sujet afin de s’assurer d’un strict respect des textes.
Comment déterminer l’autorité compétente en cas d’incertitude ?
Pour déterminer quelle est l’autorité compétente en cas d’incertitude, il convient d’adopter la même méthode que le juge administratif. Ainsi, ce dernier s’attache à rechercher quelle est la finalité exacte de l’arrêté.
Exemple : un maire prend un arrêté qui suspend pour une durée de 3 mois l’autorisation accordée aux gérants d’un établissement de produire de la musique jusqu’à 3 h 30 et de fermer à 4 h. Les juges rappellent alors que « dans les communes où la police est étatisée, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage relève du pouvoir de police municipale du maire, et le soin de réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique énumérées au 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales appartient au préfet ». L’instruction établit que « la finalité de la décision du maire n’est pas ici de faire cesser des bruits de voisinage mais, plus largement, de mettre un terme à la diffusion de musique audible de l’extérieur de l’établissement en méconnaissance de l’autorisation accordée par un arrêté précédent ainsi qu’à la répétition de cas d’ivresse grave sur la voie publique ». Pour les juges, la police étant étatisée dans cette commune, une telle décision ne relève pas de la compétence du maire mais de celle du préfet (CAA de Nantes, n° 12NT01872, 6/06/2014).
Par ailleurs, les situations peuvent devenir très complexes en cas de pluralité de motifs de troubles à l’ordre public. Dans ces circonstances, les juges recherchent si les troubles à l'ordre public résident exclusivement ou essentiellement dans des atteintes, ou non, à la tranquillité publique.
Dans une affaire, un riverain se plaint « du développement de dépôts sauvages d'ordures et de ferrailles, de l'abandon de détritus et d’épaves de véhicules sur la voie publique, du rejet incontrôlé d'eaux usées aggravé par le comblement des fossés par des débris divers, de la prolifération de rats et autres animaux nuisibles, de la divagation des chiens, chèvres et poules, de bruits et tapages nocturnes répétés, d'implantation sans autorisation de caravanes servant d'habitations permanentes et dont les occupants troublent le repos des riverains ». Les faits sont avérés, mais le maire estime qu’il n’est pas compétent pour intervenir. Pour les juges, « dans les communes dont la police est étatisée, seul relève de la compétence du préfet le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et le bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. Or, les troubles à l'ordre public dont se plaint le riverain ne résident pas ici exclusivement, ni même essentiellement, dans des atteintes à la tranquillité publique. Aussi, le maire auquel revenait le soin de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, autres que la répression des atteintes à la tranquillité publique, n'est pas fondé à faire valoir qu'il n'était pas compétent pour faire cesser ces troubles, malgré l'étatisation de la police dans la commune » (CAA de Nancy, n° 90NC00240, 25/06/1992).
Antoine Laloy le 01 février 2018 - n°26 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline