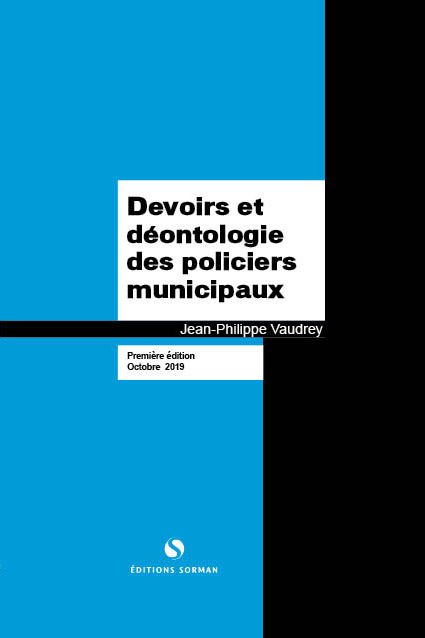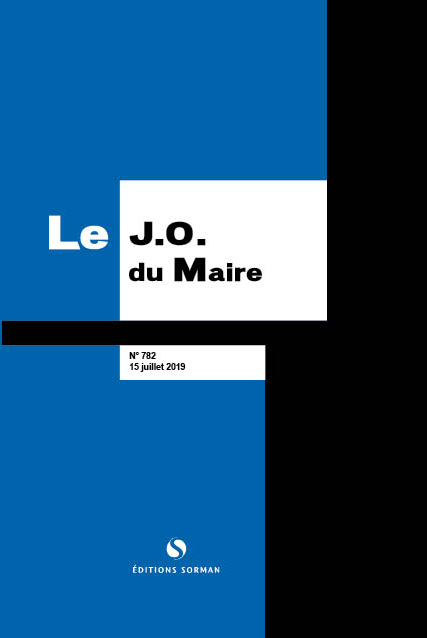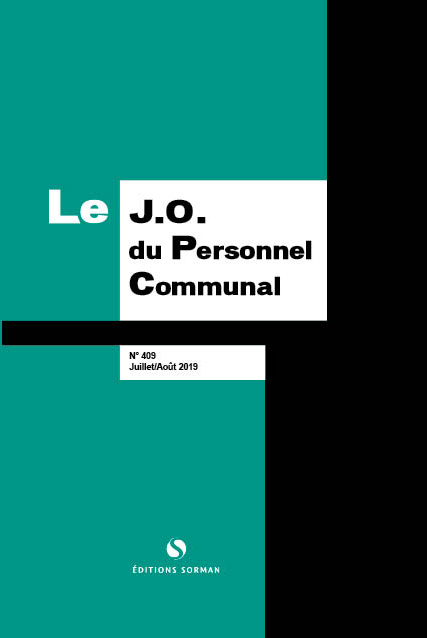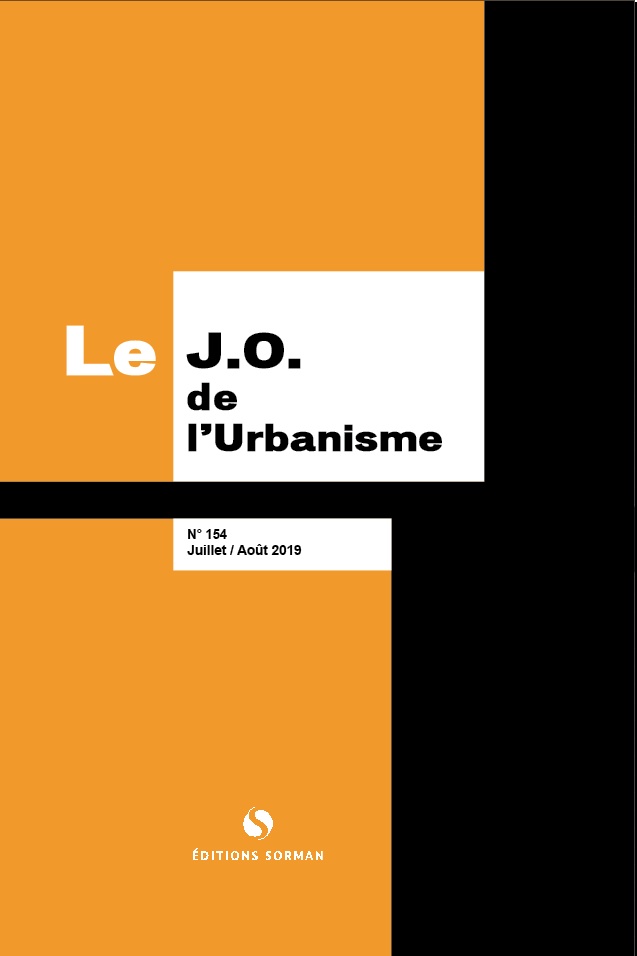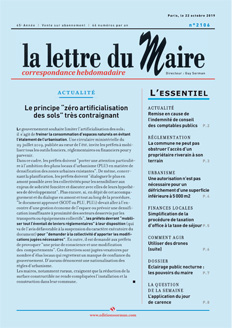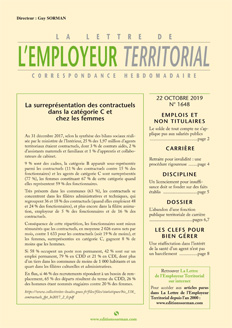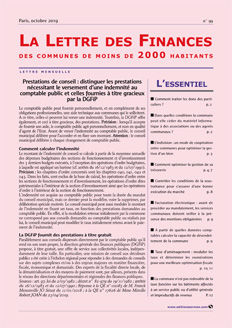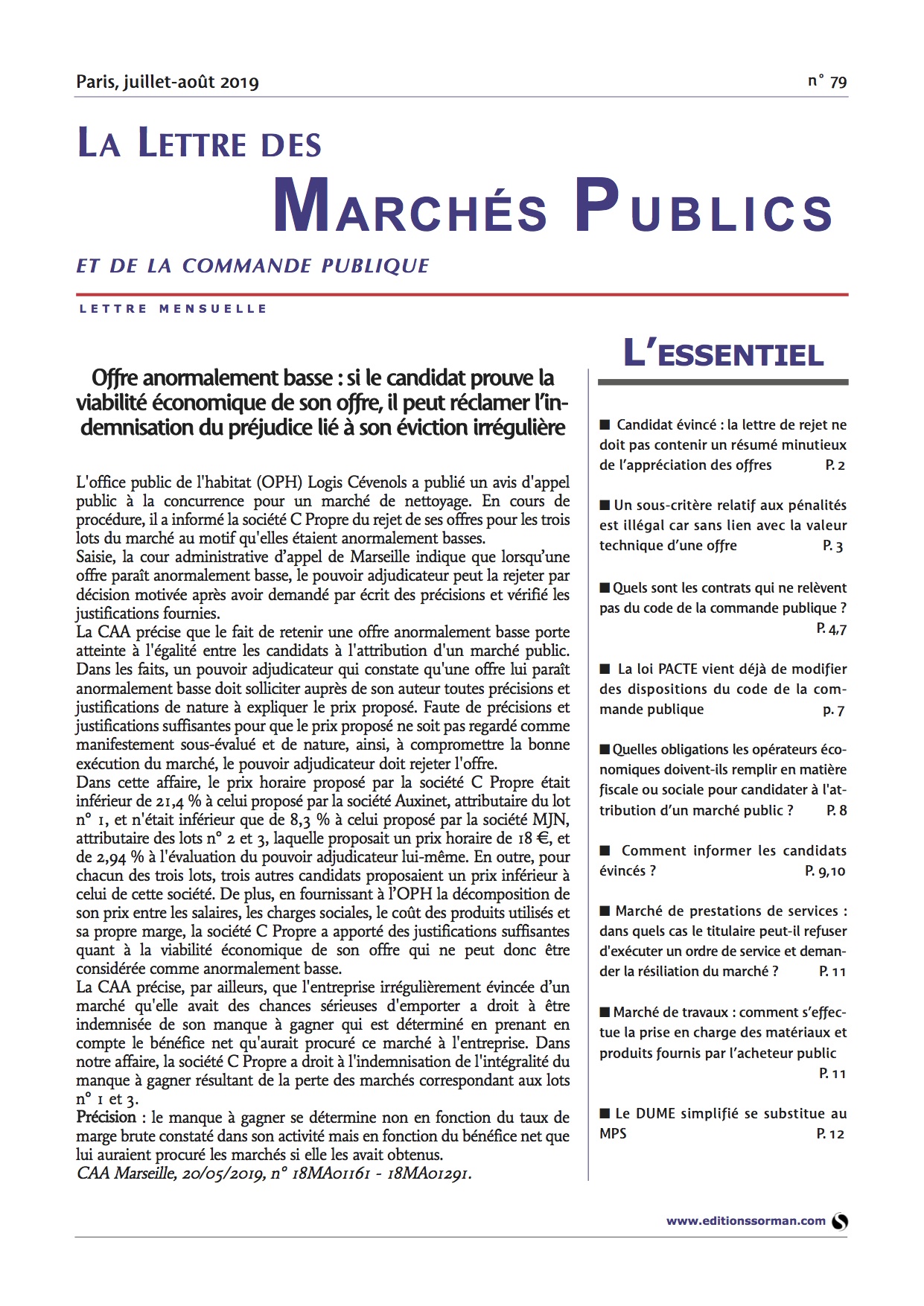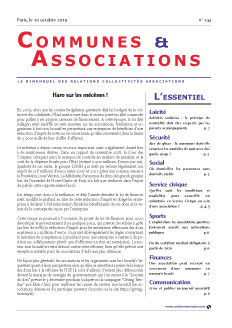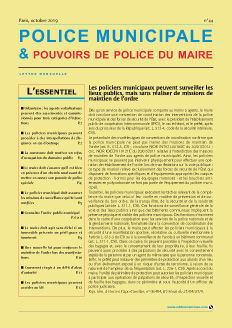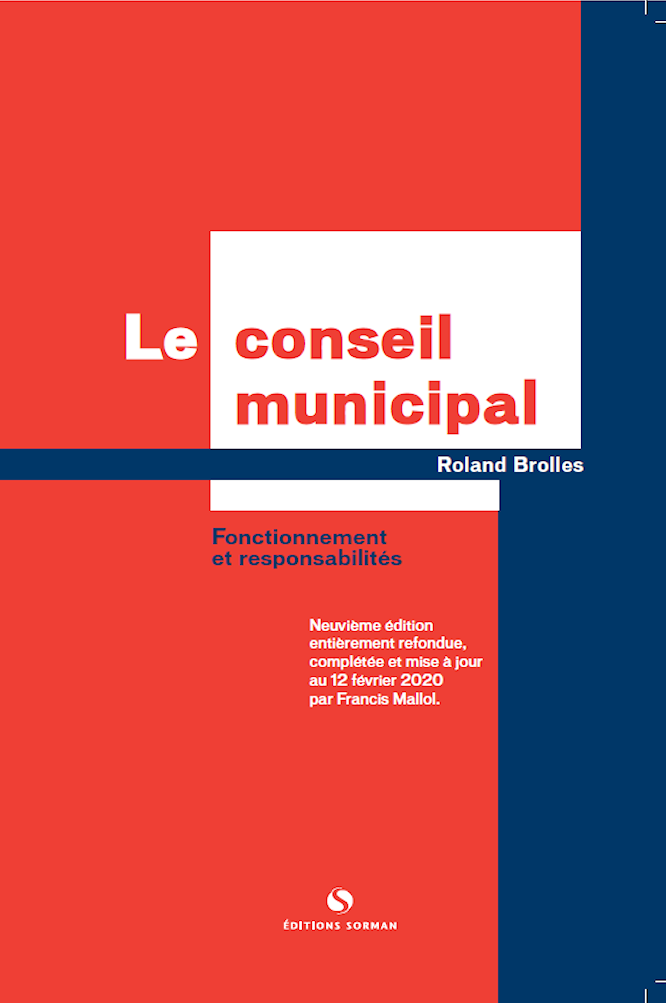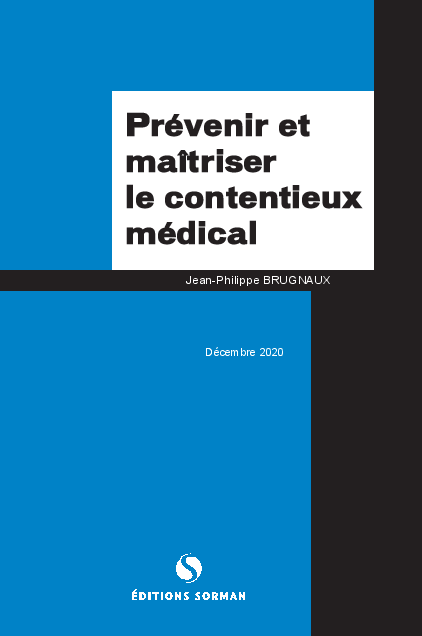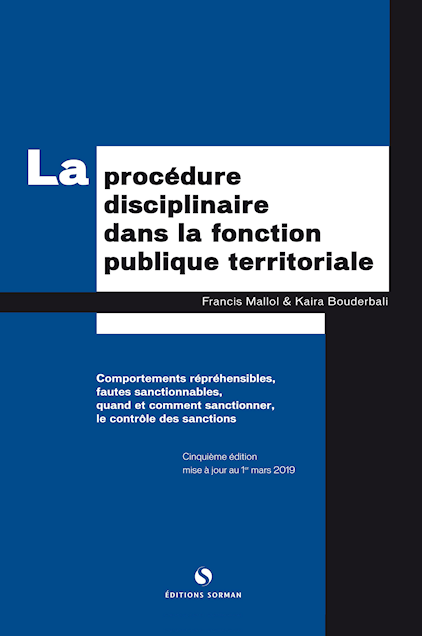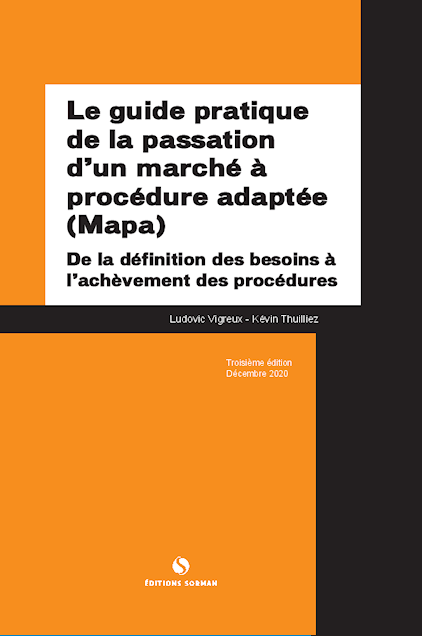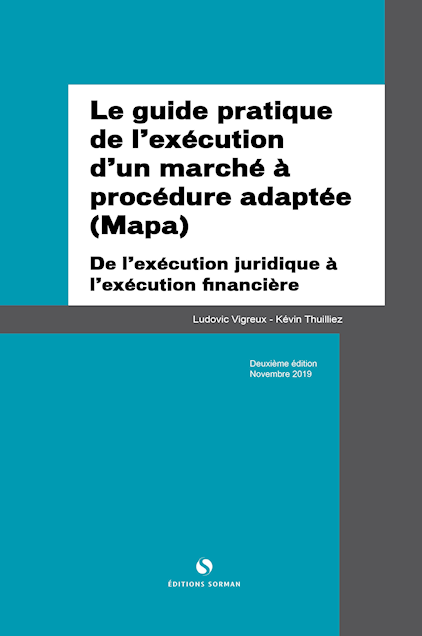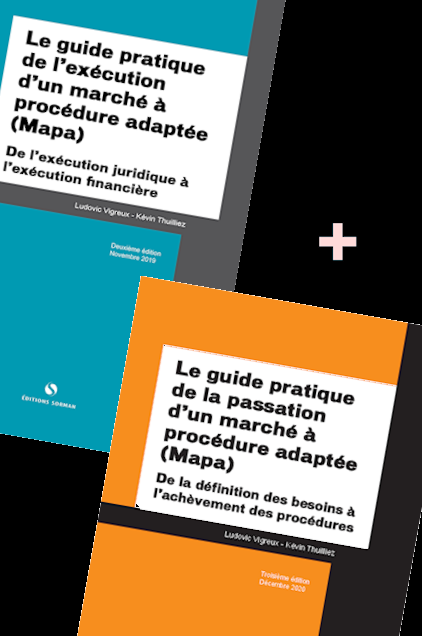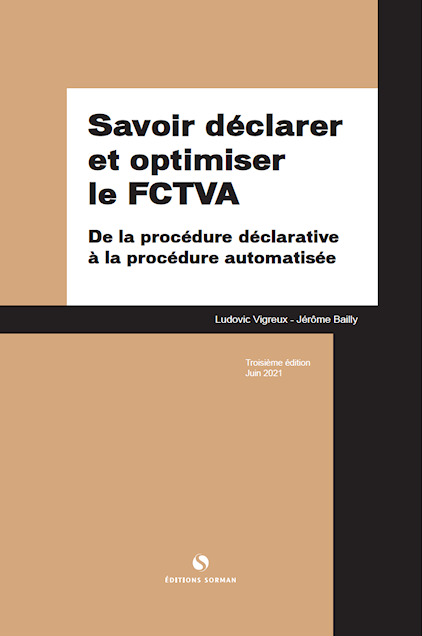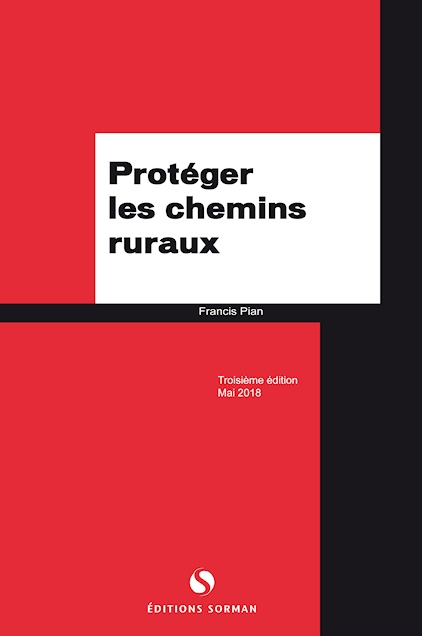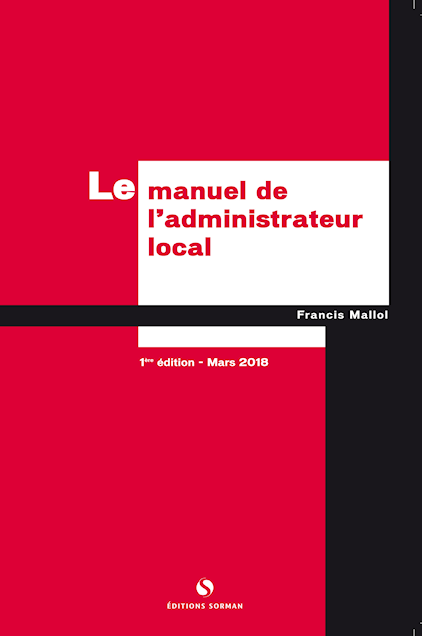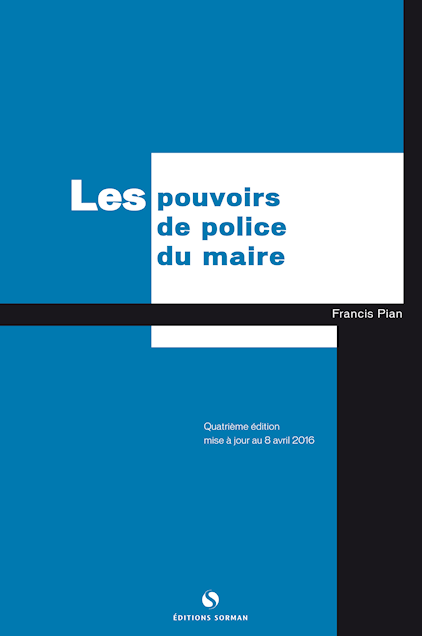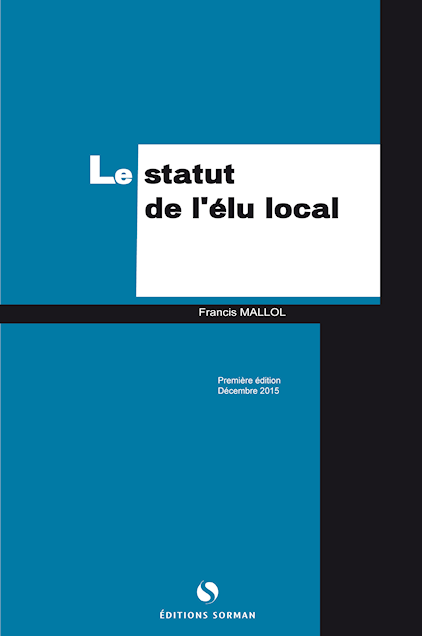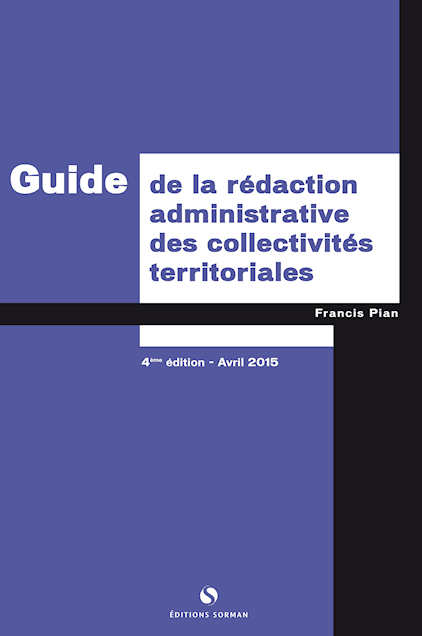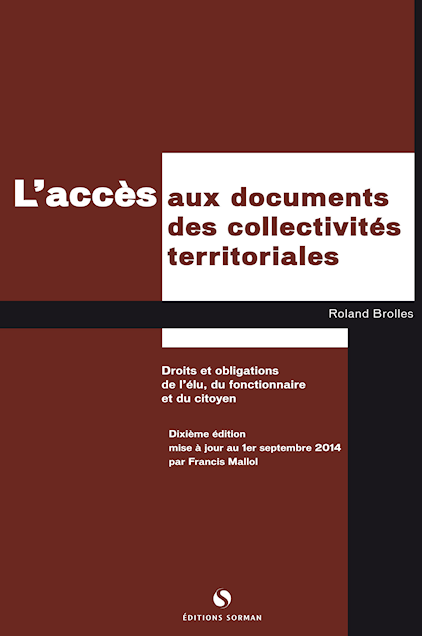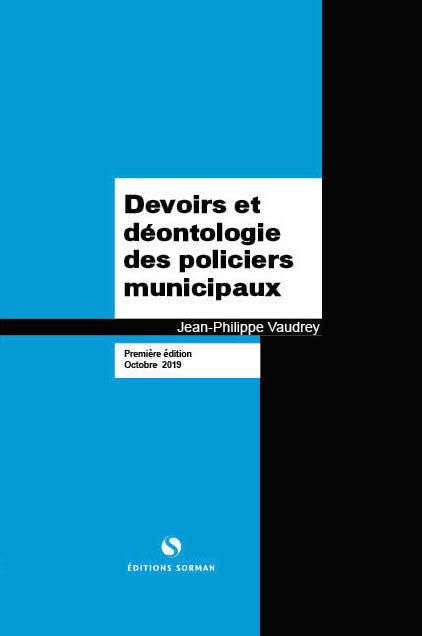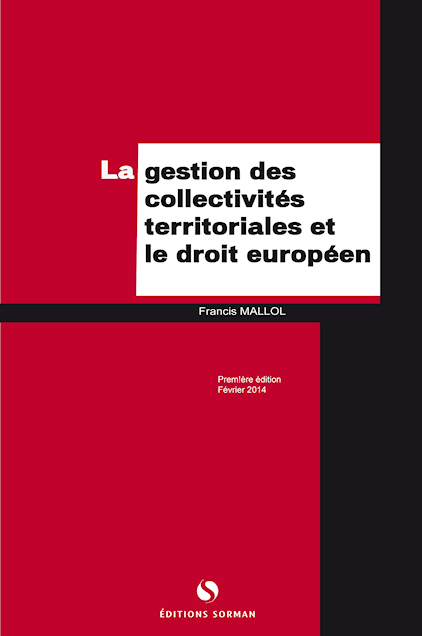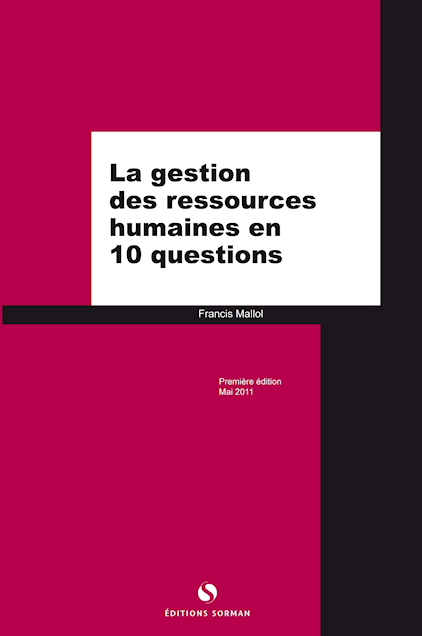Seuls les policiers municipaux peuvent surveiller la voie publique Abonnés
Le préfet sollicite le juge des référés pour qu’il suspende l’exécution de la délibération. Le tribunal fait droit à cette demande.
Tout d’abord, le tribunal rappelle qui est compétent pour assurer la sécurité publique et comment cette dernière s’organise. Ainsi, « l'État a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens (…). Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux (…) les collectivités territoriales » (art. L 111-1, code de la sécurité intérieure, CSI). Le préfet « anime et coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure » (art. L 122-1, CSI). Enfin, le maire est chargé « de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État » sous le contrôle du préfet. La police municipale a, quant à elle, pour objet « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (art. L 2212-1 et 2212-2, code général des collectivités territoriales). Aussi, « les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques », sans faire obstacle à la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale (art. L 511-1, CSI).
Pour le tribunal, seuls les policiers municipaux peuvent exercer des missions de surveillance de la voie publique pour le compte de la commune. Il suspend la délibération, car le conseil municipal ne détient d’aucun texte la compétence pour créer ce service. Rappel : le maire dispose également de prérogatives en matière de prévention de la délinquance (voir art. L 132-1 et svts CSI).
Remarque : le tribunal indique qu’il aurait pu en être autrement en présence « de circonstances exceptionnelles » (CE, 28/06/1918, Heyriès). La théorie dite « des circonstances exceptionnelles » s’applique pour répondre à un événement particulièrement exceptionnel (guerre, cataclysme), quand le cadre légal ne peut plus être respecté (le plus souvent compte tenu d’une urgence exceptionnelle) et pour un intérêt particulièrement important. Dans ces circonstances, des particuliers peuvent se substituer aux autorités publiques. Mais les conditions de mise en œuvre de cette théorie peuvent difficilement être réunies.
Tribunal administratif de Montpellier, n° 1506697, 19/01/2016, préfet de l’Hérault
Antoine Laloy le 01 avril 2016 - n°6 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline